
On peut le dire officiellement, The Cell est de loin le meilleur travail de la courte filmographie de Tarsem. Issu de la publicité et de l’industrie des clips, notre bonhomme a fait son baptême du feu avec le présent The Cell. Il lui faudra 7 ans pour achever son long métrage suivant, magnifique conte tourné sans CGI au service d’une histoire gentillette sur un candidat au suicide retrouvant goût à la vie, d’une candeur confinant à la naïveté aveugle (le monde est beau, alors la vie est belle… Gné ?). S’enfonçant maintenant dans les abîmes du navet (le débile Immortels en string or massif et l’atterrant Blanche Neige à la gentillesse insupportable), le réalisateur a complètement révélé ses limites en franchissant le point de non retour, plus aucune surprise n’étant aujourd’hui possible de sa part. Et pourtant, The Cell nous laissait espérer autre chose, ouvrant la porte sur une richesse visuelle digne d’un OFNI.
L’histoire : Carl est un psychopathe notoire qui transforme les femmes qu’il tue en poupées de porcelaine. Catherine est une psychologue œuvrant sur une machine pouvant explorer les rêves de patients. Peter est un agent du FBI aux trousses de Carl. Devinez la suite…

Clairement, The Cell peut facilement être catalogué comme un navet policier vaguement fantastique tant son traitement du suspense relève du mode d’emploi de n’importe quelle série policière. Rien ne nous est épargné. Lunettes de soleil des enquêteurs, séance de photos des cadavres, énumération complète de tous les indices, enquêtes auprès des proches en exagérant considérablement les mimiques de condoléances… Tout y passe et cela pour notre plus grand ennui. Le comble est atteint quand Peter, officiellement le héros du FBI du film, balance la tirade originale « Si on ne l’arrête pas, il ne s’arrêtera pas tout seul ! ». On a la désagréable impression d’être pris pour un con, ou alors pour un inculte n’ayant jamais vu la moindre série policière. Un constat qui alourdit considérablement le film, car entre chaque évasion onirique, nous retombons dans un réel cloisonné et d’un ennui mortel. Peter (Vince Vaughn) est ici l’un des héros les plus agaçants que j’ai pu voir dans un film, tant sa carrure de héros au service de l’ordre le rend antipathique dès sa scène d’exposition. Et ce n’est pas son mépris des psychopathes qui le rend plus tolérable, ô non… Même quand il sous entend avoir vécu une jeunesse difficile, comment peut-il encore cracher à la face de Carl au vu de son enfance traumatisée ? N’a pas dû voir M le maudit parce qu’un match de catch passait au même moment… Bref, un tiers du film est à jeter, ce qui est d’autant plus dommage… que le reste est réussi. L’exposition du psychopathe, digne d’un silence des agneaux, est un régal de plongée dans l’univers déviant de notre taré (et la scène de préparation et d’utilisation du cadavre est impressionnante). Et maintenant, on en vient aux fameuses séquences oniriques qui font tout le sel du film. Véritables délices visuels et seule vraie implication de Tarsem dans le film, elles sont toutes d’un dépaysement fabuleux, repoussant les limites de l’imagination bien plus loin que ne le laissait soupçonner sa quelconque facture de thriller lambda. Quand notre psychologue (Jennifer Lopez, supportable) revêt sa tenue ridicule, elle pénètre dans un monde formé soit de grands décors naturels d’une beauté séductrice, ou dans des locaux déviants aux ambiances variées. Eclatant complètement la temporalité (les ralentis succèdent aux accélérés, des stock shot débarquent au milieu de séquences sans prévenir), The cell passe d’une ambiance à l’autre en un fondu, se foutant de l’unité de temps et de lieu, repoussant toutes les limites, et s’offrant des visions cauchemardesques dont les rivaux se comptent sur les doigts d’une main (et ce n’est pas peu dire que The Cell rivalise avec Silent Hill au cours de quelques visions morbides dont la beauté saisit immédiatement à la gorge). Gavant sans cesse son film de visions tordues, de souvenirs fantasmés (l’enfance de Carl, vue par une porte de placard, pendant que ce derniers est envahie de bêtes repoussantes), de visions cauchemardesques (le cheval coupé en tranches) et de symboles forts (énormément d’éléments se recoupent, l’eau, les oiseaux, le chien, le sang, la religion…), The Cell fait éclater son potentiel au cours de visions aussi brèves que marquantes, qui élargissent à tout instant les possibilités d’une telle histoire. Matrix avait déjà débarqué un an avant, il fallait Tarsem et l’idée d’explorer l’imaginaire d’un psychopathe pour avoir un aperçu de l’étendue du phénomène, magnifique (et bluffante) démonstration de savoir faire technique et artistique dans l’élaboration d’un univers sans règles, en perpétuelle évolution, et sournoisement hostile. Intéressant (mais cliché) dans sa perception schizophrène du psychopathe (dominé par un roi monstrueux à la poursuite de son âme d’enfant qui se cache dans les recoins de son univers), le film parvient à rendre son psychopathe attachant, et à défaut de passionner, parvient à émouvoir pendant quelques séquences (la scène de la baignoire notamment). En s’offrant la scène de torture la plus kitchement gore qu’on ait vu au cinéma, The Cell, malgré ses défauts d’une banalité naveteuse, constitue un coup de poing filmique d’une rare inspiration, pas loin du coup de maître si il n’y avait pas cette intrigue policière dont nous n’avons que foutre. Une excellente surprise.
4/6
2000
de Tarsem Singh
avec Jennifer Lopez, Vincent D'Onofrio
























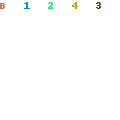

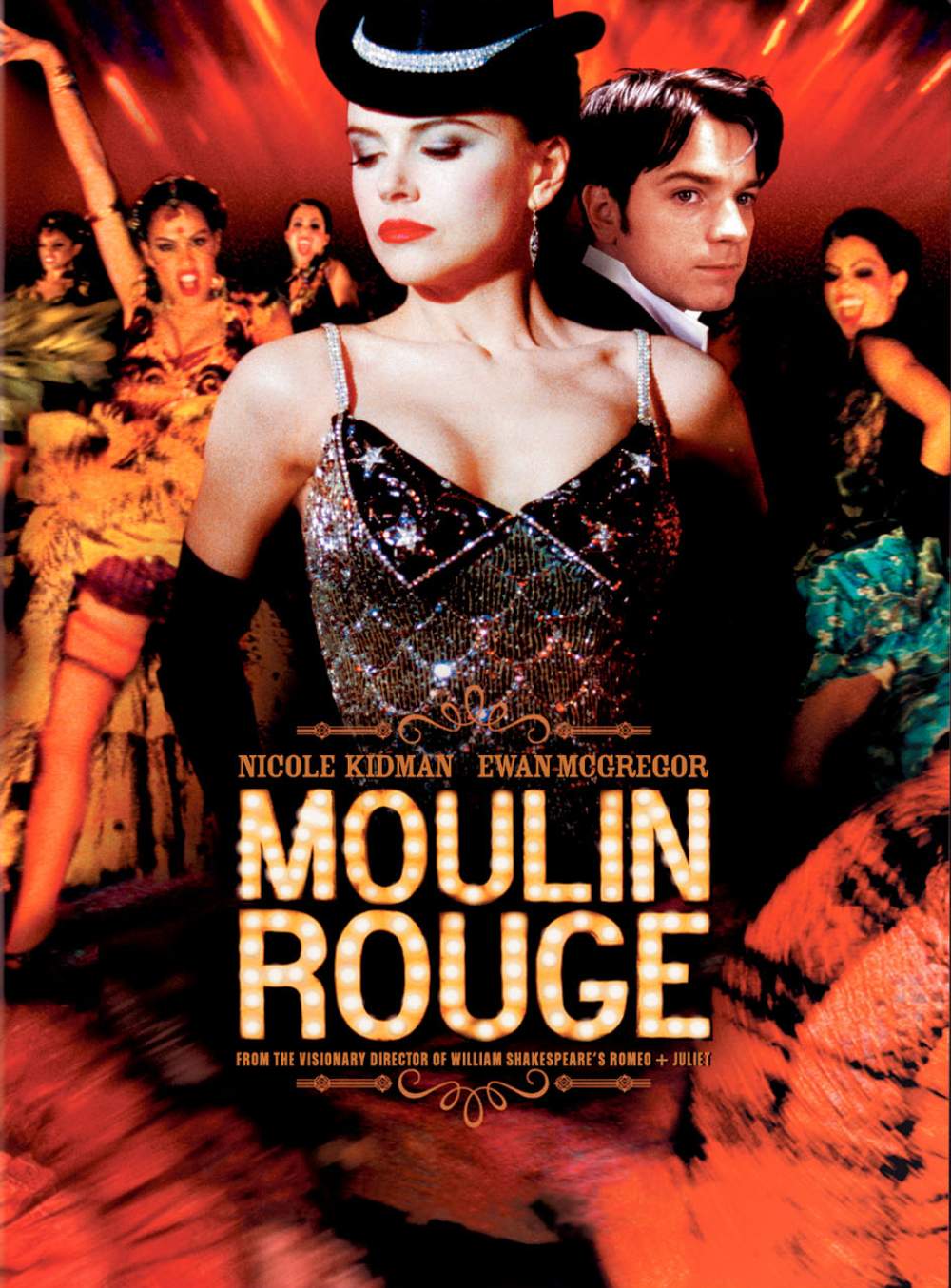

/image%2F1146095%2F20141207%2Fob_ff5f5b_oliver-wetter-port03.jpg)
/image%2F1146095%2F20150214%2Fob_c9c312_yelblu.jpg)