


Dario Argento s’est certes spécialisé dans le Giallo en mettant en scène des tueurs adeptes de l’arme blanche s’attaquant à différentes femmes. Mais il lui est arrivé aussi d’expérimenter sur le terrain du fantastique en recyclant ses codes du thriller pour relever son spectacle. En résulte une trilogie assez renommée : le cycle des trois mères. Avec un premier Suspiria (1977) dont le baroque éclatant l’a rendu instantanément culte (mon préféré de sa filmographie), Dario donnait à la sorcellerie un goût nouveau, en nous faisant découvrir une confrérie de sorcières qui œuvraient dans l’ombre d’une école de danse. Un bon prétexte pour nous entourer de jeunes vierges (focalisées sur leur avenir dans le monde de l’art), et qui sur le plan d’ambiance pourrait passer pour un ancêtre de Black Swan. Peu de temps après (1979), Argento remet le couvert avec Inferno , qui pousse à nouveau le baroque jusqu’à son paroxysme, au point de se donner des airs rococos avec sa mémorable association de bleu et de rose. Dans sa seconde moitié, Dario parviendra quand même à ressusciter l’esprit de Suspiria, et à augurer du meilleur pour sa suite. Suite qui n’arrivera qu’en 2007 et qui laissera les fans totalement sur le carreau, abasourdis par le ratage monumental de l’œuvre. Mais si Dario a totalement enterré ce qui faisait la sympathie des premiers volets de sa trilogie, il expérimente de nouvelles choses, tentant de trouver un style pour le nouveau millénaire qui redonnerait un nouveau souffle à sa carrière. Convertissons-nous quelques instants au culte de ces divinités païennes.

Suspiria : Que dire, si ce n’est que Suspiria a bouleversé ma vision du cinéma, en me faisant voir tout simplement un aboutissement frisant la perfection de ce qu’un film à ambiance peut faire. Pour bien me faire comprendre, je vais tenter de décrire comment est-ce que je ressens un film italien quand j’en vois un. La fluidité de la narration, qu’on privilégie généralement dans notre cinéma hexagonal et en Amérique, n’est que peu importante quand on regarde l’œuvre. On se mettrait alors à pointer des tas d’incohérences qui gâcheraient complètement le spectacle. C’est un cinéma de l’instant, où c’est l’ambiance des séquences qui fait la force du film. Ce sont des séquences graphiques fortes, dont l’ambiance doit être efficace, qui sont reliées par une trame plus ou moins bien ficelée. On fonctionne donc plutôt dans le registre de la sensation. Et Suspiria s’engage à fond dans cette voie, en multipliant les éclairages fantaisistes et les montées de musique accompagnées de bruitages. C’est d’ailleurs tout simplement la bande originale la plus hypnotisante, la plus obsédante de la filmographie d’Argento (avec Phenomena), revenant régulièrement alors que les éclairages s’affolent pendant que le stress monte avec l’héroïne. Dans son film, le réalisateur s’intéresse à Suzy, une jeune danseuse qui vient prendre des cours pour se spécialiser. Elle pénètre donc dans un bâtiment à l’architecture baroque ultra chiadé, où la symétrie et la surenchère des couleurs semblent être les règles d’or. Les décors permettent déjà de créer une ambiance étrange, peu rassurante pour l’étrangeté de sa décoration et ses associations de couleurs parfois angoissantes. Au niveau de ses scènes marquantes, Dario y va fort, en nous offrant tout simplement dans ses quinze premières minutes l’un des meurtres les plus graphiques de sa filmographie, faisant littéralement d’une pierre deux coups. Une scène presque traumatisante, la violence réapparaissant souvent à l’improviste (les multiples poignardages), et surtout ayant eu lieu d’une façon totalement inattendue (à part une ombre, il n’y avait personne à la fenêtre). Par la suite, Dario préfère privilégier son ambiance par les éclairages omniprésents et sa fameuse musique, les meurtres suivants n’égalant jamais l’intensité de cette flamboyante introduction. On retiendra surtout un grenier bourré d’asticots dans les scènes dérangeantes. Le final du film conclut toutefois bien son sujet, nous livrant l’explication de la curieuse absence de la Mater Suspiriarum au cours d’une scène plutôt stressante, mais un peu expédiée. Au final, Dario signe un film flamboyant, à la direction artistique ultra chiadée et aux acteurs plus convaincants que d’habitude (même si le jeu reste parfois théâtral), tout simplement une merveille du film d’ambiance (on aura rarement autant vécu un film sur des plans visuels et auditifs). Tout simplement un chef d’œuvre.
6/6
de Dario Argento
avec Jessica Harper, Joan Bennett

Inferno : Dario revient pour la suite de sa plus grande réussite avec Inferno, projet devant mettre en scène la Mater tenebrarum, la plus puissante des trois mères, qui s’est établie à New York dans un hôtel luxueux. Dès le départ, Argento tient à nous rassurer sur le visuel du film, qui a l’air de s’annoncer tout aussi chiadé que Suspiria. Il joue particulièrement sur l’association d’éclairage bleu/rose, un assemblage sensoriel qui ne met pas vraiment à l’aise (que viendra appuyer les fréquentes remarques des protagonistes : « Quelle odeur étrange… »). Inferno joue avant tout sur le malaise du spectateur plutôt que sur l’angoisse. L’introduction joue particulièrement là-dessus, essayant de pousser le malaise jusqu’à l’écœurement lors de la séquence sous-marine en profondeur. Par ses nouveaux choix artistiques, le réalisateur témoigne de la volonté de changer les mécanismes de peur qu’il employait pour faire évoluer son récit. La mise en scène continue cependant d’en mettre plein la vue (l’élève au chat dans l’amphithéâtre de l’école de musique) et d’assurer le spectacle jusqu’au bout. On constate vite que Dario revient à ses premières mises en scènes avec un héros masculin, confronté ici à plusieurs suppôts de la mater tenebrarum, en tout cas à new york. Car le réalisateur a pour ambition de faire un film qui bouge. Il y a toute une partie qui se passe à Rome même, particulièrement dans un musée riche en textes anciens, qui est carrément le théâtre d’actes de sorcellerie. Une menace inter nationale en quelque sorte, qui ne recule devant rien pour conserver le Silentium sur ses activités. Dario rend la menace de la sorcellerie plus présente, plus angoissante, en faisant notamment de l’habituel assassin de ses films un être difforme qui ne vit que par ses bras poilus achevés par des mains griffues (la Bête humaine, en quelque sorte).Dario abandonne peu à peu sa chère association bleu/rose au fur et à mesure que le suspense remonte au profit d’une palette de couleurs plus riche, tendant à le rapprocher de Suspiria. Et une bonne chose en plus : les meurtres sont plus bien organisés en terme d’intensité pure. Le meurtre dans l’appartement dont les plombs sautent est en lui-même une belle réussite (un impact identique à l’introduction de La maison près du cimetière), mais le suivant, un égorgement dans une fenêtre brisée, l’égale (éclairage rouge terriblement organique). On n’évitera cependant pas quelques digressions, comme cet antiquaire noyant une quinzaine de chats avant d’être dévoré vivant par des rats. Une conclusion toujours un peu brusque, mais Dario nous réserve encore quelques surprises, notamment dans la découverte du vrai visage de la deuxième mère, qui jaillira carrément d’un miroir. Rien à redire en face de ce spectacle prodigieux, digne successeur de Suspiria, et augurant du meilleur pour la suite, le réalisateur n’ayant pas perdu de vue l’esprit de sa saga.
5.5/6
de Dario Argento
avec Sacha Pitoeff, Daria Nicolodi

Mother of tears : Ouh là ! On m’a tellement rebattu les oreilles avec celui là ! Littéralement assassiné par la critique (Mad movies l’a descendu en flèche), peu d’entrain auprès des fans, ce film a donné le coup de grâce à la carrière d’Argento, qui depuis enchaîne les tollés et les mauvaises critiques (mais au moins, il continue d’essayer, et il a réussit au moins une fois : Jenifer, le meilleur segment de la saison 1 des Master of horror). Au risque de choquer les connaisseurs, je ne trouve pas que ce film soit un étron pelliculaire. Je lui reconnais même quelques moments d’ambiance bien faits, plombés par des fautes de goût monstrueuses. Dario fait ici le choix de briser l’esprit de sa saga en laissant tomber les éclairages fantasmagoriques qui faisaient tout le charme des deux premiers volets, en souhaitant diriger son film sur l’horreur pure plutôt que le fantasme (et c’est un peu ce qu’on lui reproche, son film perdant alors l’approche originale de son sujet). Au niveau de l’histoire, ce n’est pas trop mal torché quand même : une sorte de boîte de Pandore contenant des objets mystiques et la troisième mère, libérée par des employées au musée de Rome (ce qui est un peu étrange, la Mater Lacrimarum devant résider dans une bâtisse). La première scène de meurtre révèle à elle seule les nouvelles failles du style d’Argento : il abuse du noir par manque d’éclairage (son action devient beaucoup moins lisible), il se lance dans le sanglant au premier degré sans qu’il n’y ait plus de suspense, et il alterne les bons et les mauvais effets spéciaux (l’employée commençant à être étranglée avec ses intestins… puis avec des tuyaux en plastique souillés). Les fautes de goûts seront d’ailleurs légion dans ce film. Que dire de cette escalade de violence dans Rome, sensée être représenté par de pauvres altercations entre figurants (une femme balance un bébé dans le Tibre, deux gars cassent une voiture : c’est l’anarchie dans la cité !) ? Et que dire de ces sorcières débarquant à Rome qui ont toutes la gueule des mannequins de chez L’Oréal (et qui sont méchantes parce qu’elles n’arrêtent pas de rigoler entre elles en se moquant des passants) ? Asia Argento va-t-elle réussir à triompher du Ouistiti lancé à ses trousses ? Suis-je bête, c’est sa mère mal incrustée en post prod qui va lui donner des conseils ! Et pourquoi les possédés qui s’attaquent à Asia ne manifestent pas d’un peu plus de hargne une fois qu’ils la tiennent ? Bourré d’incohérences que l’ambiance ne parvient pas à faire oublier, le constat est sévère. Mais par moments, Argento parvient à faire illusion. Dans quelques séquences comme le meurtre du prêtre ou la remontée à l’appartement, il y a un peu de tension. Quelques designs de monstres sympathiques, et une traque dans les catacombes plutôt intéressante dans Rome, qui en cache des kilomètres carré. Par ailleurs, si on se force un peu à oublier les pathétiques illustrations de folie collective, l’ambiance parvient presque à être efficace, le contexte de possession de masse se révélant plutôt original (l’un des rares à l’avoir illustré étant le controversé La Malédiction finale). En bref, c’est loin d’être bon, c’est même carrément décevant sur certains points (le dénouement à la lance est pathétiquement cheap), mais Dario a encore quelques restes. En revanche, Asia Argento joue abominablement mal, guère aidée par ses talents de jeune sorcière. Un cru décevant, mais pas encore infâmant comme a pu se révéler Giallo.
1,5/6
de Dario Argento
avec Asia Argento, Moran Atias

"J'avais tellement pas de tripes qu'ils ont pris des tuyaux pour m'étrangler !"
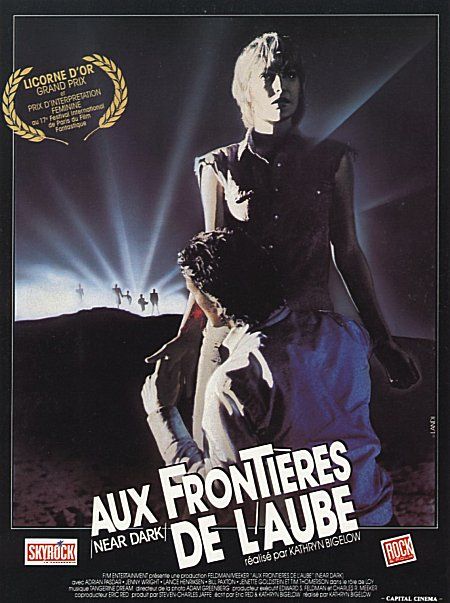




























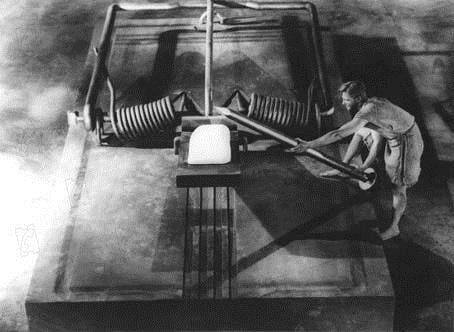





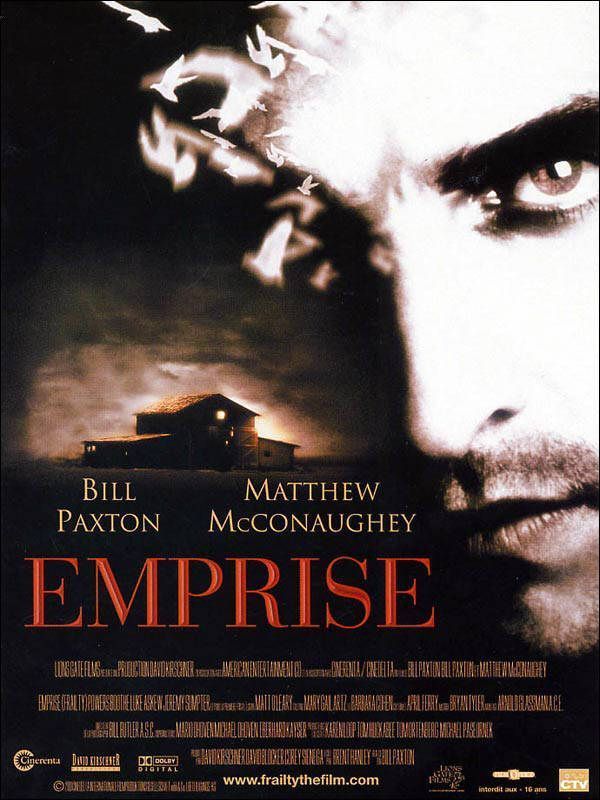





/image%2F1146095%2F20141207%2Fob_ff5f5b_oliver-wetter-port03.jpg)
/image%2F1146095%2F20150214%2Fob_c9c312_yelblu.jpg)