Petite production espagnole bénéficiant d'un buzz critique (quand on affiche le nom d'Almodovar sur l'affiche, ça aide), les nouveaux sauvages est la petite production qui défraye la chronique, se faisant sa petite niche avant la sortie de Taken 3 et du TV film oscarisable the imitation game. Une petite sortie discrète pour un film dont la modestie et les qualités se révèlent taper dans les tensions sociales avec une certaine justesse qui joue la carte de la fraîcheur.
L'histoire : 6 petits sketchs de plus en plus développés, axés sur les tensions du contexte et les pétages de câble des protagonistes.
Objectivement, les nouveaux sauvages est un bon petit film, qui a eu l'idée brillante de taper dans les codes sociaux que j'apprécie, puisqu'il s'intéresse à des mécanismes de violence et de frustration en changeant régulièrement le cadre, le ton et les personnages. C'est sa certaine légèreté globale de ton qui est d'abord privilégiée via sa première histoire, une vengeance froide, calculée et méthodique, dont l'issue a indéniablement quelque chose de jubilatoire. Et chaque petite histoire d'y aller avec une ironie plus ou moins revendiquée, n'hésitant jamais à changer de registre quand cela se révèle original ou approprié. Le second sketch doit être le plus violent, traité avec un second degré minimal (les interventions du type "un poison périmé, c'est plus ou c'est moins dangereux ?"), avec un sacré malaise à la clé, immédiat contrepied à la vengeance parfaite du pré générique. Pas forcément utile ou jubilatoire, mais bon contrepoint à la surprise de l'introduction, et démonstration manifeste de l'intensité du ton que le film peut adopter. La troisième est ma préférée avec la dernière, s'appuyant sur un climat à la Hitcher et fonctionnant sur les banales incivilités au volant. Un postulat partant d'une situation banale qui dégénère avec une gradation bien dosée, avec un humour noir d'une violence jubilatoire. On voit un affrontement en direct à coups de clé à molette et d'extincteurs avec un rire régulier et une plongée dans le glauque vraiment bien dosée. Cette histoire sera d'ailleurs surement celle qui marquera le plus les spectateurs. L'histoire suivante suit un artificier qui suite à une contravention, se voit pris dans les enfers de l'administration pénale qui enchaîne les amendes avec une logique là encore bien gradée. Car le nerf de cette histoire, c'est bien sûr d'appliquer des pénalités cumulées en incitant au calme (respect des civilités imposé...). Avec, là encore, cette conclusion jubilatoire qui a le bon goût de se terminer sur une note légère, peu réaliste, mais qui au moins retrouve un peu de légèreté. S'en suit le segment sérieux du film, la violence n'est pas représentée, seul les impacts seront à l'écran. La classique situation du maquillage d'une affaire criminelle, où chacun y cherche son intérêt, et dont les règles dépendent essentiellement de celui qui pose les conditions. Pas virtuose, mais suffisamment bien détaillé pour se livrer à un portrait bien sec de mécanismes de corruption. Et enfin, la dernière histoire, probablement la plus développée, qui salit une grande fête de mariage et le fait culminer dans l'anéantissement des illusions à un niveau virtuose. Départ classique avec tromperie éventée, puis basculement psychologique dans la surenchère de rabaissement mutuel, qui donne le vertige de par sa plongée sans borne dans les coups bas. Les rapports de force entre mari et mariée changeant sans cesse alors pour s'accumuler dans un final qui plonge aussi les invités dans la tourmente. Alors, après la spirale, le film désamorce. Essentiellement pour s'assurer la légèreté de ton qu'il voulait employer, et pour ménager une issue à la fatalité qu'il se plaisait à souligner (la femme trompée finit par ne plus camoufler ses prétentions vénales une fois qu'elle se sent en position de force). C'est Gone girl en condensé, mais en moins machiavélique. Résultat, on est un peu hésitant, entre la satisfaction de voir les banalités d'une union éclatée par les griefs personnels (tel un mélancolia hystérique) et l'issue gentillette qui atténue grandement la férocité du propos. A trop vouloir être gentil, le film finit un peu par brosser dans le sens du poil le spectateur, préférant finalement le calme au pétage de câble total.
2015
de Damián Szifron
avec Ricardo Darín, Oscar Martinez







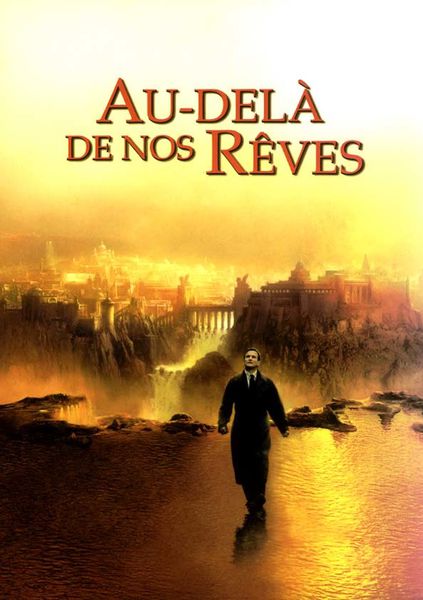

























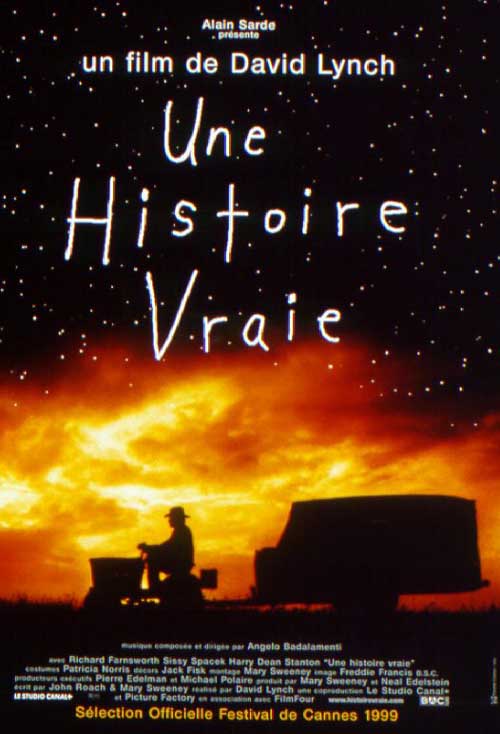

/image%2F1146095%2F20141207%2Fob_ff5f5b_oliver-wetter-port03.jpg)
/image%2F1146095%2F20150214%2Fob_c9c312_yelblu.jpg)