Avec All night long, on tient une saga underground japonaise ultra-violente dont l’aura pourrait être comparée à celle des fameux Guinea pig. Elle se rapproche en tout cas de l’esprit du premier, dans ce qu’elle a de plus voyeuriste et malsain, focalisée sur la mise en scène d’histoires perverses à base d’ultra violence physique et psychologique. Si le premier assure sa mission sans grand génie, le second est celui qui possède la réputation la plus sulfureuse. Histoire d’aller au vif du sujet, commençons par ce que la saga a de meilleur à offrir.
L’histoire : un geek asocial (pléonasme) est harcelé et régulièrement battu par une bande de jeunes désoeuvrés, dirigés par un leader particulièrement attaché à lui, tout en laissant libre cour à un amour pervers…
L’intérêt de ce petit film (une heure vingt, sans rapport avec les autres opus de la saga) réside moins dans son ultra violence physique que dans son climat psychologique. Particulièrement avec le personnage du méchant, qui ne peut s’empêcher de torturer inévitablement toutes les personnes auxquelles il s’attache, la psychopathie manifeste de ce dernier lui faisant mépriser le monde entier. En cela, son portrait est particulièrement abouti, jusqu’à l’excès quand on voit que sa bande le suit toujours alors qu’il a torturé l’un d’entre eux. Beau, lunatique et parfaitement ambigu d’un bout à l’autre du film, il est le genre de méchant qu’on affectionne immédiatement, car il jouera la carte de son caractère jusqu’au bout. Vient maintenant le côté troublant du film (qui me fait hésiter sur le ressenti global plutôt bon que j’ai éprouvé). Ce film est un film homosexuel. Mais au dernier degré. Souvent, dans le cinéma, les homosexuels sont des victimes plus ou moins coriaces dans le cinéma d’horreur (seule petite exception anecdotique : le nanar Hellbent). Ou à la rigueur, un psychopathe jaloux ou possessif (l’excellent Talentueux Mr Ripley). Mais ici, c’est l’ensemble du film qui est la tribune de psychopathes homosexuels déviants. La quasi intégralité des protagonistes sont masculins, et dès les 5 premières minutes, le grand nombre de comportements ambigus ou explicites ne trompe pas sur les tendances en cours. Notre personnage principal est introduit d’office comme un jouet victime (en bonne partie consentant), racketté et battus par les brutes pendant que l’apollon sadique contemple la scène avant d’y ajouter sa contribution mêlée d’avances. Le malaise introduit est total, d’une puissance comparable à celle de l’épisode 0 d’Ichi the killer. C’est sur la vision des femmes que le film m’a en revanche beaucoup heurté, et dont les intentions me semblent douteuses. Ces dernières sont humiliées sur toute la longueur du film. Mais une véritable humiliation, une dégradation totale et sans borne, de la Femme en général. Une adolescente violée transformée en chienne d’appartement, totalement consentante, et encourageant les pulsions vicieuses des hommes alentours, une autre qui n’a absolument aucune contenance, qui se défend en poussant de pathétiques gémissements inoffensifs, et qui une fois droguée se livre avec complaisance aux perversions du groupe d’ado. Dans chaque détail, le film fait l’apologie de la femme objet, inconsistante en dehors de ses organes sexuels (« si vous n’aviez pas ce trou, vous seriez totalement inutiles ») et réduite en bas de l’échelle du respect social. Autant d’acharnement a de quoi semer le doute, et braquer sans doute une bonne partie des spectateurs, même dans l’extrême, à son encontre. Cependant, ce viol moral soutient particulièrement bien cet étrange climat qui imprègne le film, qui consomme le malaise jusqu’au bout, conservant cette atmosphère gay délétère jusqu’à son paroxysme dans la demeure du chef, dont plusieurs scènes ultra violentes bien réfléchies permettent de pousser au maximum les déviances de chacun. Hélas, le film capote quand il cède à la boucherie, s’embourbant dans le classique pétage de câble sans queue ni tête qui fuit à défaut de conclure (cette phrase, « c’est demain la rentrée ! », n’ouvre sur rien). Mais malgré cette déconvenue, l’atmosphère qui imprègne ce film, particulièrement jusqu’auboutiste (notre geek affiche lui aussi des pulsions sadiques, parfois avec une virtuosité malsaine assez frappante), procure le malaise promis par la réputation. Une horreur ultime dans un univers ultra masculin, misogyne et partiellement ambigu.
1955
de Katsuya Matsumura
avec Masashi Endô, Ryôka Yuzuki, Masahito Takahashi


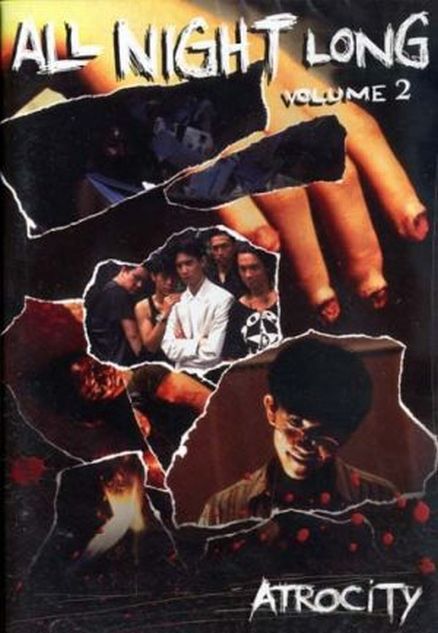




/image%2F1146095%2F20141026%2Fob_954c10_vlcsnap-90896.jpg)
/image%2F1146095%2F20141026%2Fob_41f01a_vlcsnap-92938.jpg)
/image%2F1146095%2F20141026%2Fob_13a577_vlcsnap-96278.jpg)
/image%2F1146095%2F20141026%2Fob_30e133_vlcsnap-97178.jpg)



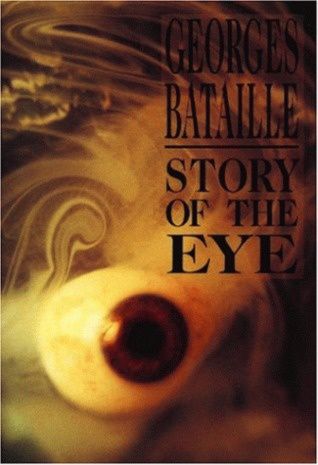



















/image%2F1146095%2F20141207%2Fob_ff5f5b_oliver-wetter-port03.jpg)
/image%2F1146095%2F20150214%2Fob_c9c312_yelblu.jpg)