


Shinya Tsukamoto est reconnu comme réalisateur de films punks, à tendance expérimentale, et ayant fréquemment recours à la violence. De toutes ses œuvres, Tetsuo est largement la plus citée, faisant office de monument au panthéon des films expérimentaux, et partant du postulat démentiel de voir un homme se transformer définitivement en machine. Après un premier film incroyablement percutant (un choc lors de la découverte), Tsukamoto décide de se lancer dans une fausse suite en 1992, Tetsuo 2, The body hammer, qui si il reprend le même univers, va traiter son sujet plus sous un angle d’action / film de fou japonais (Meatball Machine semble venir de là). Ce n’est plus une œuvre expérimentale agressive, mais un film cyber punk incontestablement jouissif (c’est d’ailleurs celui qui est le mieux filmé). Et alors qu’on se délectait encore de ces deux perles, voilà que le projet Tetsuo 3, The Bullet man sort pratiquement à l’improviste. Dans ce dernier film, une envie de lisser un peu les contours, même si le résultat final tient globalement plus du 2 que du 1. Les séquences expérimentales sont ici plus rare, éliminées au profit de l’action qui donne par moment carrément dans la gunfight. Toutefois, les accélérés sont beaucoup plus frénétiques, et on peut dire que c’est cette frénésie qui vient redonner du peps à un Tetsuo 2 parfois plus mou. La rage est de nouveau au cœur du film, ce qui fait de ce cru une redite esthétisée et pas déplaisante.

Testuo : Voici un film qui aura hypnotisé on ne sait combien de cinéphiles (pouvant endurer le style expérimental), puisque la force de ses images suffit à motiver le spectateur pour le suivre pendant une heure. Mais quelle heure ! S’appuyant sur une métaphore simple mais efficace (l’homme concassé par la société qui devient une machine), et qui va nous faire partager un véritable trip punk, gore et ultra violent. L’introduction plante d’office les obsessions esthétiques du film : des câbles électriques qui pendent, de la graisse sur les murs, une sensation étouffante de confinement et des décors d’usine. Un inconnu se mutile pour s’enfoncer un tuyau dans la jambe (on voit sur ses murs des dizaines de photos de sportifs, ce qui laisse planer l’idée que l’homme cultive une quête de performance chez le corps humain), avant de piquer un 100 mètres et de finir percuté par une voiture. Arrive la séquence de présentation de notre personnage principal : un gars en costard qui bosse dans un bureau et qui semble ici secoué de gestes désordonnés (une sorte de rage) sur une musique au rythme industrielle. C’est parti. On suit alors le quotidien de ce cadre, complètement formaté à une existence codifiée, méticuleusement pensée et qui ne cède jamais à la moindre folie. La scène devant le miroir, première saillie gore, sera le premier élément perturbateur de la journée du héros. S’ensuit une longue conversation entre notre homme et sa maîtresse, à qui il répète inlassablement la même chose en pensant à ce qu’il pourrait lui faire, sans pour autant passer à l’acte. C’est seulement après que la première manifestation machine organisme aura lieu, sous la forme d’une femme au poignet infecté. Cette scène sera d’ailleurs la première où on découvrira qu’une sorte de démon planqué dans la mécanique (l’instinct ?) investira les corps qui se transforment en machine. Ce premier contact, violent (arrachage d’oreille, plantage de stylo dans la gorge…), laisse entrevoir les futurs séquences marquantes de Tetsuo, à savoir ces fameux plans séquence accélérés où le protagoniste se déplace à toute allure dans les rues de la villes. Au cours de l’affrontement avec la possédée, notre personnage est à son tour contaminé par ce démon mécanique. Commence alors la transformation physique et psychique du héros, qui passe de l’état de victime à celui de monstre. Pour le pétage de câble, on prendra comme référence la séquence où le héros, impuissant, se fait sodomiser par un démon féminin arborant un gigantesque tuyau en guise de phallus. Niveau symboles sexuels, le film ne dose pas ses effets, ne perdant jamais une occasion de revenir à ces symboles pour conserver l’impact viscéral de l’œuvre. Mais cet impact est sans cesse entretenu par la transformation progressive de notre homme en machine, ce dernier arborant bientôt une monstrueuse perceuse à la place de son sexe (sa partenaire, véritable bête de sexe que notre homme ne va pas ménager, en fera les frais). Et bientôt, c’est l’amalgame chaotique entre chair et métal, où tout n’est plus que tuyaux et muscles. Passé ce stade, c’est carrément le mobilier qui se transforme, réorganisant les objets, fusionnant les êtres vivants présents dans les environs (on aura le cas du chat fusionnant avec des ustensiles électro-ménagers et des aliments)… A ce stade, l’incarnation du démon mécanique ne nous surprend plus, mais les séquences qui suivent, graphiquement très fortes, nous conduisent tout droit à la confrontation finale dans un enchevêtrement de câbles, où notre héros mécanique et le démon fusionnent pour former un gros tank qui projette de détruire le monde. Tetsuo, c’est une ambiante démente, dynamisée par une bande originale ultra dynamique et dont les obsessions graphiques accouchent d’une ambiance malade fascinante. N’ayant jamais vu le film en sous-titré, les dialogues restent donc une énigme pour moi. Mais ils me semblent dispensables au vu de la force des images et de la musique, qui créent un extra-ordinaire univers avec peu de chose. Une saga est née.
5.5/6
1988
de Shinya Tsukamoto
avec Tomoro Taguchi, Nobu Kanaoka

Tetsuo 2, the body hammer : Après le succès de Tetsuo, Tsukamoto envisage une suite lorgnant vers quelque chose de différent. Moins violent en tout cas, car le premier constat que l’on puisse faire, c’est que la dimension sexuelle de Tetsuo 2 est très mince. En dehors de quelques plans suggestifs, finie, les séquences de sexe énervées du héros devenant machine. Toutefois, c’est toujours un personnage masculin qui sera au centre de l’histoire. Mais ce n’est plus exactement un brûlot tapant sur l’aliénation d’un individu. Certes, le portrait de famille typique propre sur elle et la carrure du père (homme rangé, conscient de ses responsabilités…) apparaissent comme des gens normaux, un échantillon de masse sans grande aspérité. Mais au cours d’une sortie course, leur fils se fait enlever dans le métro par deux punks (semblant s’être échappés de la matrice), qui font en même temps une injection brutale au père de famille. S’ensuit alors une course poursuite énervée, la caméra bouge beaucoup, mais l’action reste lisible. Le père de famille sera alors considérablement malmené, sans pour autant que la transformation attendue n’apparaisse malgré le traumatisme. Après cette introduction violente, le père tente de se donner une constitution physique plus robuste (sa façade chétive commence un peu à reculer). Mais lors de la seconde tentative d’enlèvement, et de la mort du gosse en question, que la rupture a lieu (une séquence expérimentale assez bien faite). En pleine transformation, notre héros est alors capturé et emmené dans une sorte d’usine où s’activent d’autres personnes comme lui. C’est alors qu’on comprend qu’il s’agit d’une expérience sur la fabrication d’armes humaines, des hommes qui sous l’impulsion de leur rage, pourrait transformer leur corps en arme (c’est la conclusion de Meatball Machine). S’ensuit alors l’évasion de notre body hammer (qui massacrera quelques autres sujets d’expérience moins motivés). Mais à son retour, sa femme brisée (qui le tient pour responsable de la mort de leur enfant) viendra encore renforcer les sentiments contradictoires qu’il éprouve. Mais très vite, l’enlèvement de sa femme vient relancer l’action. Décidément, Tetsuo II marche comme une machine, et il ne veut jamais s’arrêter. S’amorce alors le retour dans l’usine. Au fur et à mesure de ses combats, il se rapproche peu à peu de ses origines, son passé étant inconnu avant ses 8 ans. On en apprendra alors un peu plus sur le chef des hommes armes et sur l’enfance de notre héros, au final cobaye depuis ses plus jeunes années et pouvant être sujet à des crises dévastatrices lors de ses vagues de colère. Le final perpétue alors la tradition tetsuo, organisant cette fois ci un défilé autour du char formé par notre homme, et escorté par tous les autres hommes-armes qui gravitent autour. Si le champ expérimental du film s’est considérablement réduit, Tetsuo II continue de cultiver cet amour pour un univers bruyant, glauque et sale qui semble affranchir les individus de toutes leurs entraves (ce qui passe par la destruction de leur quotidien). Moins hypnotique que son prédécesseur, cet opus propose toutefois quelque chose de différent, élargit un peu son univers et développe des idées intéressantes, qui serviront de base à l’excellent Meatball Machine qui doit beaucoup à ce film.
4.7/6
1992
de Shinya Tsukamoto
avec Tomoro Taguchi, Nobu Kanaoka

Tetsuo, the bullet man : première surprise, Tetsuo the bullet man n’est pas une suite, c’est un remake ! Passé l’angoisse devant cette première constatation, on remarque que Tsukamoto soigne ici beaucoup son esthétique. Celle-ci est glacée pendant l’essentiel du film, il n’y aura que pendant les gunfight qu’on aura droit à un peu de jaune et de rouge. Mais l’ensemble de l’œuvre est cohérente à ce niveau, la teinte bleue de l’ensemble du film parvenant à planter quelque chose de net. La trame de l’histoire est maintenant classique, mais les imperfections de Tetsuo 2 sont ici corrigées. On commence une fois encore avec une famille troublée par des cauchemars, mais unie. Notons d’ailleurs que notre héros est ici un occidental, une première dans la saga. Sortant avec son gamin pour se promener, ce dernier est volontairement heurté par un pystérieux chauffard, qui le traîne sur 50 mètres. Le choc est brutal, et c’est le premier pétage de câble (graphiquement, c’est le même que l’introduction de Tetsuo I) et l’amorce de l’histoire. Le chauffard s’étant enfui, la femme de notre héros ne cesse de le harceler moralement pour qu’il venge la mort de leur gamin. Notre homme sent ses nerfs qui se tendent un peu plus à chaque heure. Mais la transformation ne commence que lorsque sa femme le quitte. C’est alors que débarque un tueur qui abat froidement notre héros en pleine métamorphose. Son corps est récupéré alors par le chauffard qui avait écrasé l’enfant quelques jours plus tôt. Notre héros (qui en fait n’était pas mort), s’attaque à la voiture, empli d’une rage qui n’a d’égale que la puissance de la musique de la scène. Autant dire qu’il massacre littéralement la bagnole en métamorphosant son corps. Dès sa première transformation, c’est la machine à tuer. Différence notable avec Tetsuo II : une fois transformé, la métamorphose semble se maintenir. Sous cet état, notre héros devient de plus en plus instable, étant sujet à des crises de frénésie qui seront filmées avec une hargne rare. Les gunfights sont difficilement lisibles (la caméra bouge vraiment dans tous les sens), mais on sent qu’une énergie phénoménale circule dans le film, accompagnant le personnage dans sa quête de vengeance et de son passé. Concernant ce dernier, on ne sera pas vraiment surpris d’apprendre que son père était scientifique et qu’il a servi de cobaye lui aussi à des expériences d’armes humaines (le projet tetsuo). Toutefois, le héros bénéficie ic d’un maquillage qui évolue constamment au cours du film, finissant par ressembler à un monstre insectoïde recouvert de métal, et osant dans son dernier acte devenir une arme de destruction ultime : carrément une bombe H ! Carrément plus puissant que les autres films. Cependant, ce nouveau Tetsuo, à part soigner son esthétique, ne s’est pas lancé dans des thèmes nouveaux, et n’a pas vraiment inventé la poudre. Toutefois, il mérite vraiment qu’on s’intéresse à son cas, au moins pour un épilogue qui nous ramène au point de départ (chose complètement hors de propos pour Tetsuo 1, et qui était à peine esquissée dans Tetsuo 2). Le calme après la tempête ? Toujours est-il que la beauté de ce nouveau chapitre mérite largement qu’on s’y égare, et que le traitement de Tsukamoto restant aussi enragé que pour ses autres oeuvres, s'en priver serait un péché mortel. Démentiel !
5/6
2009
de Shinya Tsukamoto
avec Eric Bossick, Akiko Monou

























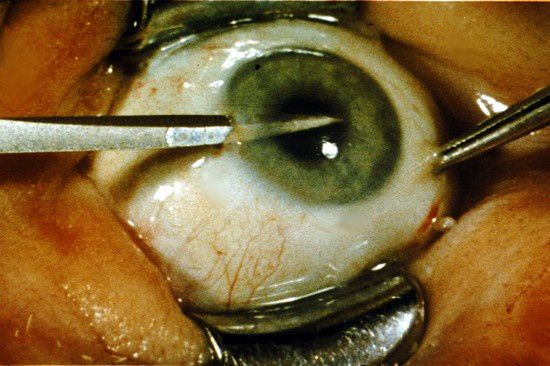











/image%2F1146095%2F20141207%2Fob_ff5f5b_oliver-wetter-port03.jpg)
/image%2F1146095%2F20150214%2Fob_c9c312_yelblu.jpg)