


Il est venu le temps de s’attaquer aux trois premiers films de la filmographie du grand Peter Jackson. Bad taste, Braindead et Meet the feebles. Trois titres mythiques, chacun d’un mauvais goût particulier, qui a réjouit une quantité incroyable de fans depuis leur sortie et qui ont acquis aujourd’hui un statut culte (voire intouchable) auprès des connaisseurs en la matière. Rare ont été les comédies aussi transgressives à leur époque, et si les films ont aussi bien vieilli (auprès d’un public de gorrophiles), c’est aussi parce que leur originalité reste intact après autant d’années, de même que leur politiquement incorrect. Et aussi, soit dit en passant, parce que leur réalisateur est devenu un des plus reconnus mondialement avec la saga du Seigneur des anneaux. Cependant, les dvds n’ont jamais été réédités en France (à part une seule réédition dvd de Bad taste introuvable, sauf auprès de collectionneurs chanceux), histoire de ménager le public TF1 qui risquerait de voir rouge devant un curé arrachant des bras de zombies. Rares, et donc réservé à un public connaisseur, ces films font presque l’unanimité dans la communauté cinéphile. Retour sur ces chefs d’œuvres de mauvais goût.

Bad taste : Dès son premier film, Peter veut mettre l’accent sur le projet complètement fou dans lequel il s’est lancé. Avec la disparition de tous les habitants d’un village, et l’envoi sur place d’une équipe de potes par une mystérieuse association, commence une comédie gore (et Z) qui se fait tout de suite remarquer par l’emploi de l’artillerie lourde : le gore inventif qui tâche. Décapitation au magnum, trépanation à la masse, crâne fissuré qui ne cesse de s’ouvrir… Le film délivre largement la marchandise, comblant les amateurs de pocharde gore dès les débuts du film. Sur le plan de la comédie, le film compte beaucoup sur l’absurde de la situation qu’il décrit pour faire penser la balance en sa faveur. C’est plus un film à l’ambiance comique qui n’a au final pas tant de gags vraiment drôles (à part l’irrésistible « Maman !! » de la VF, je me rappelle avoir plus souri que ri à proprement parler). Et cela malgré un contrôleur des impôts au mauvais endroit au mauvais moment, dont les fréquentes apparitions entraînent des situations plutôt cocasses, mais jamais transcendantes. Bad taste, c’est une ambiance complètement folle, qui réussit pourtant à garder un rythme dans sa narration, et donc qui réussit à conserver l’attention du spectateur (ce qui est quand même un bon point pour une série Z comme bad taste, à 11 000 dollars de budget). Bon point dans le film : il est de plus en plus ambitieux pendant son développement, nous réservant un final digne des mitraillages de Rambo et dépassant en absurdité le survival loufoque qu’on a vécu pendant une heure. Des extra terrestres qui viennent recharger les stocks de leur fast-food sur terre : énorme ! On nous en fait pas souvent, des twists comme ça (quoique Saw 7…). Cependant, même avec tous ces bons points, le film n’a aucun autre but que de divertir. C’est un film fait pour des fans de genre, qui n’a aucun autre but que de faire rire. Et si l’humour de circonstance reste toujours opérationnel, la rareté de vrais éclats de rire (par des gags ponctuels) diminue mon enthousiasme pour ce premier cru du sieur Jackson. Surestimé donc. Bad taste, c’est une série Z rigolote, totalement folle, mais qui ne fera pas vraiment éclater son potentiel (en partie à cause de jeux d’acteurs très approximatifs qui plomberont quelques situations amusantes, ce qui souligne davantage les traits Z du projet). Si Bad taste est aujourd’hui culte, il est moins méritant que ses petits frères.
3.5/6
1987
de Peter Jackson
avec Peter Jackson, Terry Potter

Avec Meet the feebles, Peter Jackson fait preuve d'innovation, puisqu'il s'adonne à la parodie du Muppet Show, avec la finesse qu'on connaît depuis ses précédents excès. Mais dès les cinq premières minutes, le film en balance tellement que le mot "parodie" n'a plus assez de force pour définir l'horreur visuelle à laquelle on est en train d'assister. C'est simple, Meet the Feebles est un film volontairement moche, à l'image des personnages qu'il met en scène. L'usage des marionnettes est ici obligatoire, car outre ses vertus parodiques envers les Muppets, il permet à Peter de s'affranchir de toute bienséance qu'aurait imposé un tournage avec des acteurs (ses précédentes créations se montrent très timides sur ce terrain). Résultat : si Braindead sera l'apothéose du film gore, Meet the feebles est le mètre étalon du film trash. Ce film est un étalage constant de mauvais goût, de dérives sexuelles et de trafic de stupéfiants qui ferait vomir n'importe quel amateur de bon cinéma. En surenchère perpétuelle avec lui-même, mettant tous ses personnages en concurrence pour trouver celui qui sera le plus crade, c'est le concours que s'impose Jackson dans ce film qu'on pourrait qualifier de plus excessif de sa carrière, non en termes de mise en scène, mais de violence morale. Le film égratigne tous ses personnages, de la cantatrice d'opéra au vétéran du Viêt-Nam (l'hilarante parodie de Voyage au bout de l'enfer). Mais derrière cette peinture malade de la société du spectacle télévisé, il y a un drame d'une cruauté monstrueuse, une peinture de caractères d'une méchanceté si grande qu'ils parviennent à devenir crédibles. Bletch est un des déchets humains les plus nocifs qu'il m'ait été donné de voir au cinéma, pliant à ses désirs de jeunes étoiles montantes du show-business, dirigeant d'une main de fer son théâtre et produisant du porno pour arrondir ses fins de mois, quand il ne touche pas au trafic de poudre. Surenchère, mais son caractère reste constant, prévisible, et par conséquent crédible (car agissant selon les rouages d'une logique pourrie). Trevor est un exemple parfait du contremaître satisfait d'être à cheval entre deux statuts, caressant sa hiérarchie et rabaissant ses employés. Du côté des « gentils », ce n’est guère mieux avec une chanteuse obèse qui croit que le monde tourne autour d’elle (ce qui est vrai dans un premier temps, et qui ne rendra sa chute que plus dure). Le personnage jouera d’ailleurs un rôle intéressant sur la fin, son pétage de câble permettant à Jackson d’y faire voir une parodie de Rambo (qui dans le genre pétage de câble défie bon nombre de péloches), permettant en plus de faire une parodie, d’y créer une rage destructrice qui sied à merveille au ton hargneux de tout le récit. Meet the feebles est plus qu’une œuvre trash vouée à être culte auprès de fans obscurs aux goûts douteux, c’est aussi une sorte de brouillon pour un drame qui aurait pu être joué au premier degré. Du vrai cinéma grimé comme un délire lubrique qui aguiche ses spectateurs avec un mauvais goût revendiqué (le trip du sexe nasal). D’ailleurs, le film tente de créer des sentiments au cours de son final. De la peur avec Robert en face du lanceur de couteaux camé jusqu’aux yeux en plein bad trip devant une salle bondée, de la haine en face d’un Bletch dont on attendra la mort avec une hâte non dissimulée, et un moment de cinéma avec Heidi chantant sa chanson dans une pièce jonchée de cadavres. Le spectacle tentait de prendre du sérieux, et y parvenait presque. Mais Jackson, dans un ultime trait de moquerie, les sabre avec des portraits de dernière minute énonçant le futur de ses personnages, ultime éclat de rire de cette farce ultra glauque et d’un goût douteux, qui laisse déjà apparaître certaines ambitions de Peter, qui aspire déjà à manipuler un registre sentimental riche. Etonnant, et au final aussi attachant qu’un Braindead.
5.5/6


Braindead : Ah, on s’attaque à du lourd, ici. Longtemps considéré comme le film le plus gore de tous les temps (mais maintenant, il est remis en balance par des projets du type Philosophy of a Knife), ce film est tout simplement un maître étalon du mauvais goût, dans la mesure où le jeu outrancier de tous les personnages colle parfaitement à l’ambiance artificiellement folle du projet. En effet, le film compile d’énormes clichés connus (le héros timide, la mère possessive, la prophétie de tarot…) et les fait tous gonfler, gonfler, jusqu’à ce qu’ils explosent comme des ballons de baudruches remplis de pus. Jackson a voulu explorer un nouveau type d’humour noir : celui de la surenchère dans le morbide. Faire tout simplement une compilation des morts les plus graphiques de l’histoire du cinéma, et toutes les concentrer dans un seul et même film. Un excès novateur qui lui assurera définitivement le succès, le film parvenant toujours à être drôle, et incontestablement jouissif (les mises à mort sont toutes plus folles les unes que les autres, et permettent de caractériser par la suite des zombies qu’on retrouvera plusieurs fois jusqu’au final gargantuesque. Le film n’a plus peur de se limiter. C’est de la boulimie gore, rarement la crasse n’aura été aussi copieusement étalée à l’écran. Il faut tout simplement lire les témoignages des membres de l’équipe, qui tournaient en imperméables et qui passaient plusieurs heures chaque soir à nettoyer les décors et le matériel de tournage. Mais en tentant de garder son sérieux, on constatera aussi que Braindead est parfaitement maîtrisé par son auteur. C’est simple, il ne manque pas un plan. Le film est toujours compréhensible, bien monté et lisible, alors que certains passages sont vraiment rythmés (le dernier acte dans la maison, avec des personnages séparés qui suivent chacun leur parcours, aurait pu être beaucoup plus bordélique). Enfin, en bon amateur de mauvais goût, Peter Jackson ne respecte rien, et se montre d’une incroyable générosité en termes de personnages cultes (le cousin de famille lubrique, le prêtre karatéka) et d’humour douteux (le bébé zombie). Jusqu’auboutiste, le film se permet même de l’être avec les caractères de ses personnages, illustrant ainsi la relation sur-protectrice mère fils avec des symboles gores qu’on n’attendait pas, et qui réussissent à porter leurs fruits. Joignant le geste à la parole, Lionel rompt le cordon familial sans un final gorrissime et dégoulinant, qui conclut assez habilement ce drame familial ultra cliché dans ses thèmes, mais dynamisé par un usage totalement surdosé de gore gratuit qui non content de faire jubiler le public, se révèle un pari artistique plutôt audacieux. Au final, Braindead a de bons atouts pour faire l’unanimité. Tout est une question de goûts (Bad taste a ses fans, certains trouveront Braindead vraiment too much), mais pour ceux qui en ont assurément de mauvais, le film se révèle un défouloir inespéré.
5.5/6
1992
de Peter Jackson
avec Thimothy Balme, Diana Penalver

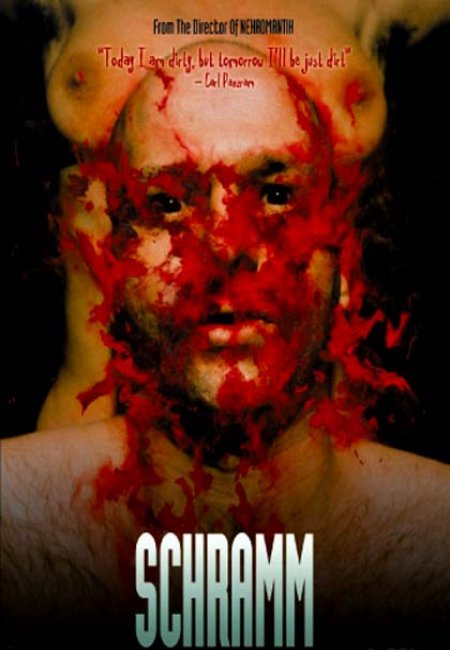









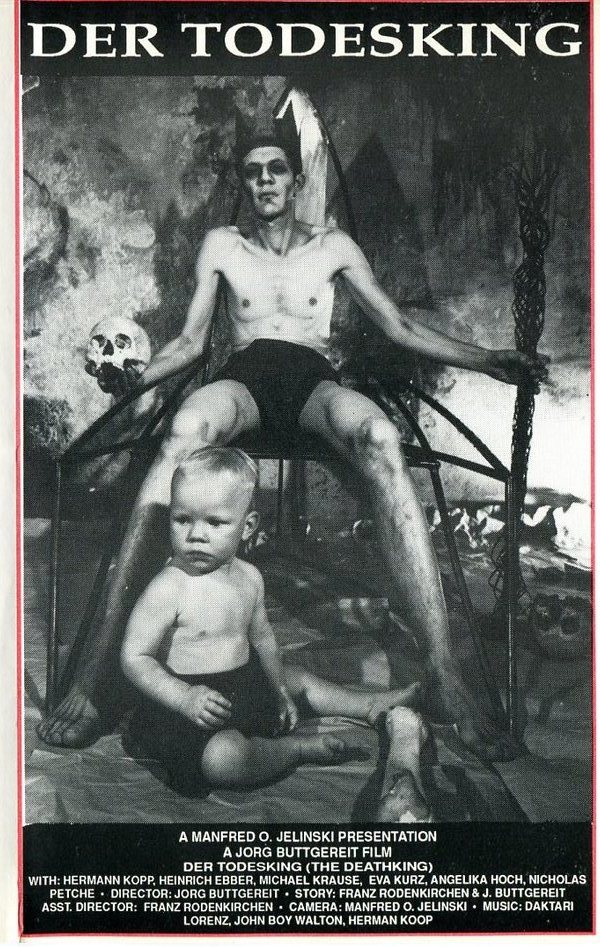













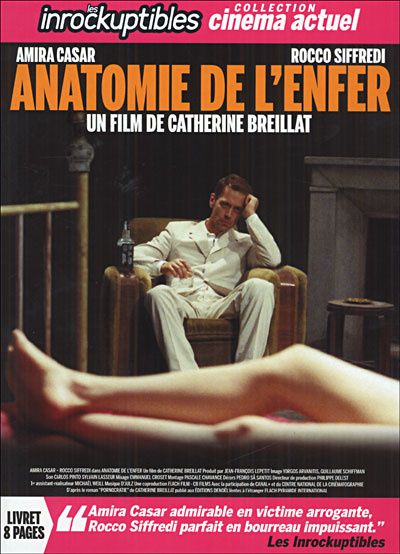


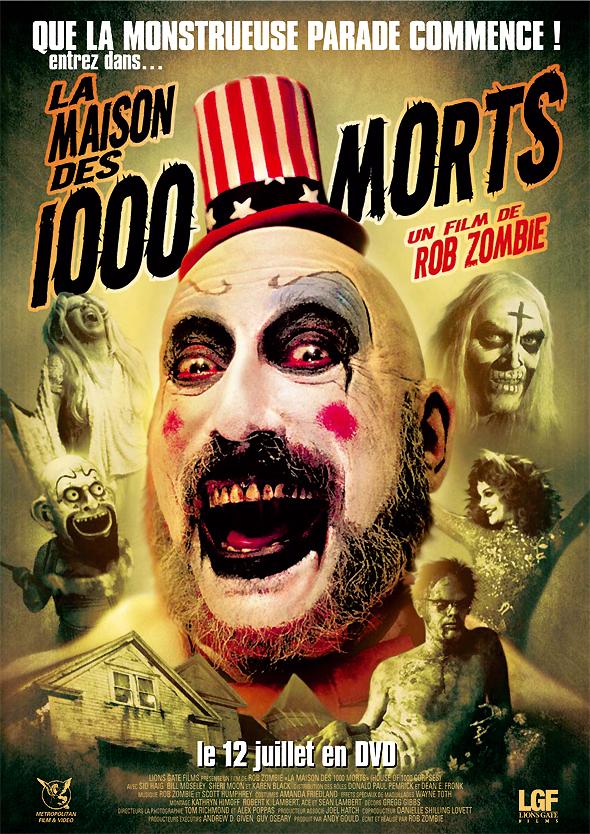













/image%2F1146095%2F20141207%2Fob_ff5f5b_oliver-wetter-port03.jpg)
/image%2F1146095%2F20150214%2Fob_c9c312_yelblu.jpg)