Sea fog s'attaquait au délicat sujet des passeurs (ici, dans le contexte classique de passage entre les deux Corées) avec des promesses de noirceurs et de réalisme. Un bon sujet qui ne devrait toutefois pas être mené comme un Transperce-neige pour pouvoir prétendre s'inscrire un peu dans la réalité. Coup de bol, le film s'intéresse davantage aux actions des personnages qu'à un point de vue moral, ce qui donne quelques explosions de violence bien dramatisées car elles sont complètement logiques dans le contexte, et qu'elles s'enchaînent de façon cohérente. On suis donc toutes les étapes qui amènent une équipe de pêcheurs sur la paille à passer dans le traffic d'immigrés clandestins, assurant le passage d'un gros groupe d'entre eux. A ce stade, le film est sommaire dans sa caractérisation des protagonistes, et conservera sa démarche quand les choses se corsent (en trouvant un côté proche de Dogville, évidemment avec la touche asiatique qui exagère toujours un peu le trait). C'est un peu ce qui nuance le jusqu'auboutisme du film : les attitudes de ses personnages se manifestent parfois avec trop peu de retenue pour éviter l'appellation de clichés. Mais ces clichés fonctionnent, et jouent leur rôle dans la suite des évènements.
Le personnage du capitaine est surement l'un des plus intéressants à suivre, car il est celui qui lance la démarche et qui prend l'essentiel des décisions au cours de la traversée. Il est aussi celuiqui endosse toute la responsabilité de l'affaire si les choses tournent mal. Planté dans un contexte de délabrement moral lorgnant vers l'apathie (réaction molle et ton résigné quand il apprend que sa femme le trompe), il garde finalement comme stricte motivation la remise en état de son instrument de travail qui demeure sa dernière fierté. Et quand il s'agit de gérer les clandestins, c'est celui qui met rapidement les points sur les i en faisant preuve de violence quand il sent la moindre menace pesant sur ses responsabilités. C'est finalement en cela qu'il apparaît comme le plus radical des personnages, sans avoir toutefois de penchants pour l'humiliation ou la domination des clandestins (contrairement à une autre partie de l'équipage, qui les méprise plus ou moins ouvertement). Il est simplement sans pitié et assume toujours ses choix jusqu'au bout, avec logique et pragmatisme.
C'est d'ailleurs ce pragmatisme qui permet à Sea Fog de prendre un peu de distance par rapport à son message social (bien présent, parfois appuyé (surtout dans la VF, médiocre)), laissant les actes parler et contemplant avec impartialité le déroulement du voyage. C'est le retournement tragique de milieu de film qui le fait vraiment évoluer vers un climat beaucoup plus viscéral que le simple pensum humaniste, en lorgnant vers une sorte de thriller survival bien plus immersive et efficace que ne renierait pas dans le glauque un certain Lars von Trier. Précis et efficace, il brode sa fiction sur une issue potentielle de ces voyages illégaux, en se retenant de passer dans le registre tragique par de nouveaux enjeux qui assurent l'originalité et la tension du récit. Très bonne surprise que ce Sea Fog, qui rejoint Deephan dans la case des films sur l'émigration qui touchent juste.










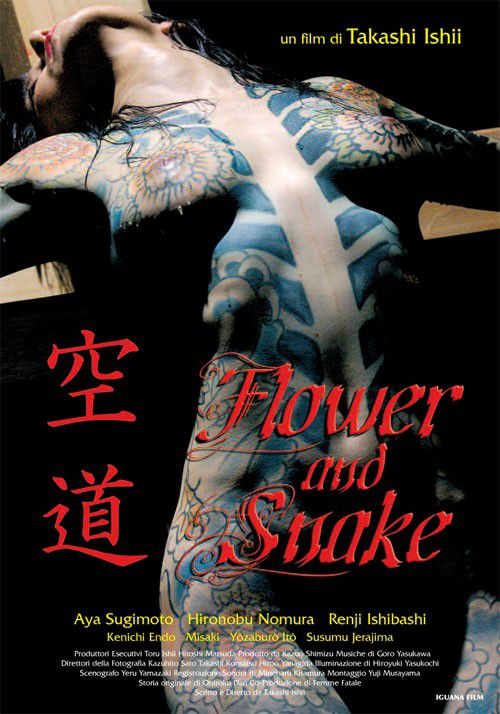

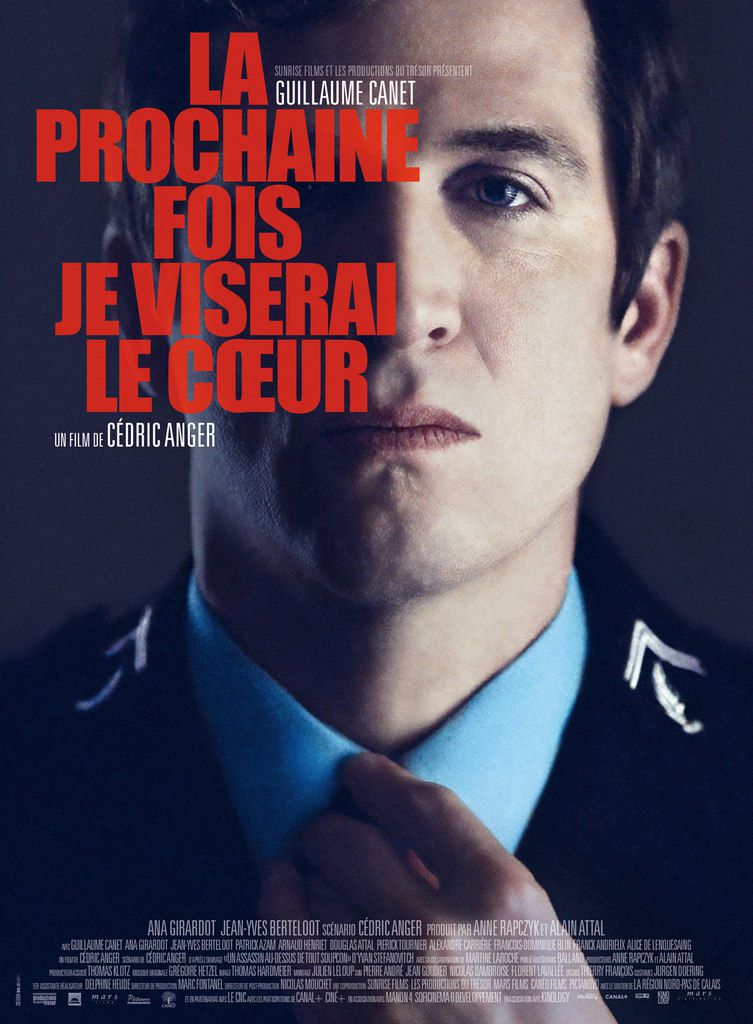

















/image%2F1146095%2F20141207%2Fob_ff5f5b_oliver-wetter-port03.jpg)
/image%2F1146095%2F20150214%2Fob_c9c312_yelblu.jpg)