
Avec Shame, Steve McQueen s’attaque à un sujet mainte fois rebattus, mais toujours capable d’enflammer les foules : la sexualité. Toutefois, si elle est omniprésente et qu’on constate régulièrement les interférences avec le personnage, elle n’occupe pas complètement le film, laissant les personnages s’exprimer. Chronique psychologique sobre et très léchée (l’esthétique lumineuse du film est impeccable), Shame met surtout en relief l’extra-ordinaire performance de Michael Fassbender, qui se révèle être l’un des meilleurs acteurs internationaux de notre décennie cinématographique.
L’histoire : Brandon Sullivan est séduisant, proche de la quarantaine, et il consacre son temps libre à la sexualité. Omniprésente, jusqu’à ce que sa sœur, chanteuse paumée et suicidaire, vienne habiter chez lui quelques jours. Son quotidien s’en trouve alors complètement frustré.

Shame s’attaque à son sujet en plan direct, sans détour. Si il filme la nudité avec un certain sens de la mesure (les élans sexuels de nos personnages évitent fréquemment de filmer en plan large, se focalisant sur des détails, Fassbender n’apparaîtra nu que quand il est seul (face à ses désirs)), il ne cache pas son intérêt pour le sujet, le plaçant d’entrée de jeu au centre du récit. Sous une façade affable et sociable, Brandon cultive une obsession : la performance. Son désir est omniprésent (il occupe quasiment la totalité de son temps libre, constitué de sites porno et de visites d’hôtesses de luxe), il interfère avec son travail (son disque dur professionnel bourré de photos obscènes, ses fréquentes séances de masturbation dans les toilettes du bureau), a façonné sa manière de pensée (son aversion pour le mariage, sa froideur pour les conquêtes qui tentent de le récupérer…). L’équilibre est précaire, mais Brandon y trouve son compte, flirtant au quotidien et doté d’un charisme animal qui fait littéralement craquer toutes les femmes. La séquence dans le métro, peu après l’ouverture, dépasse en efficacité la naissance du désir qu’on avait pu voir dans Pulsions de DePalma (la fameuse séquence du musée d’art). Par de simples regards et quelques mouvements de lèvres, c’est une attraction qui se crée puis qui s’étouffe. Probablement la séquence la plus virtuose du film. Alors que son patron lui annonce que son ordinateur est en manutention (pour cause de virus informatique, venant d’on ne sait où…), Brandon voit sa sœur Sissi débarquer dans son appartement et s’installer pour quelques jours. Cette relation frère-sœur sera la seconde préoccupation du film, qui reste centré sur Brandon (émotionnellement, on captera toutes les sensations de ce personnage, et de la relation crispée qu’il entretient avec sa sœur, partagé entre un certain devoir moral et la frustration de voir son quotidien inavouable perturbé. Car c’est le côté inavouable de ses passions qui ressort avec Brandon. En temps que fan de cinéma, on peut citer des références, communiquer facilement et en parler naturellement. Mais un passionné du sexe doit tout intérioriser, ne pouvant vraiment s’exprimer qu’avec une partenaire, et pendant un court laps de temps. Le culte de la performance ne pousse que vers des sensations intenses, mais éphémères, et socialement non constructives. Si Brandon parle clairement de son désintérêt pour la stabilité du couple, il est aussi incapable de pratiquer dans un contexte où il se sent émotionnellement impliqué (son aventure avec Marianne, employée de bureau récemment divorcée). L’équilibre ténu se rompt avec de simples détails, aussi l’envahissement de la sœur entraîne crispation et peu à peu engueulades (Brandon déguise merveilleusement ses pensées, avançant un point de vue logique alors que ses préoccupations sont surtout d’ordre sexuel). Alors que Brandon se laisse dériver le temps d’une nuit (une plongée un peu plus sombre dans son trouble où son chrisme sexuel lui vaut un tabassage et une courte aventure dans une boîte gay), Sissi déprime, incapable de faire face à son frère même si ayant cernée en partie le problème (la honteuse séquence de surprise de Brandon dans la salle de bain en pleine masturbation). Le final, dramatique mais un peu attendu, ne conclut pas. Il donne une teinte plus grave au personnage, plus mélancolique. Le personnage a reculé sur ses envies, si il a conservé son charisme, il n’est plus sur l’offensive. Il fait rentrer de nouveaux facteurs dans son jeu. Peut être un nouveau point de départ, que la narration laisse en suspens. Si les performances de tous les acteurs sont au niveau, le film s’appuie clairement sur le charisme de Michael Fassbender, qui interprète à la perfection son personnage (chacun de ses mouvements est millimétré, pensé pour l’incarner à la perfection). On savait l’acteur virtuose, mais sa performance est ici irréprochable, le plantant comme une des figures d’acteurs les plus importantes de ces deux dernières décennies (bon, je cire un peu les pompes de Fassbender, mais le fait est là : il ressort dans tous les films où il joue). Si le film se contente d’être une chronique sociale relativisant clairement la tendance à la performance sexuelle, il ne cherche pas non plus à donner une autre piste morale (le patron de Brandon est un père de famille qui drague continuellement les femmes qui l’entourent, là où Brandon n’a besoin que d’un regard pour les faire fondre). Il s’assume comme une composition d’acteurs excellente et un portrait aussi esthétique qu’abouti (même si l’errance gay me paraît un poil too much dans le contexte de performance, bien que « l’idée » soit compréhensible). Un film intéressant, et une œuvre d’auteur plutôt séduisante.
4.8/6
2011
de Steve McQueen
avec Michael Fassbender, Carey Mulligan





















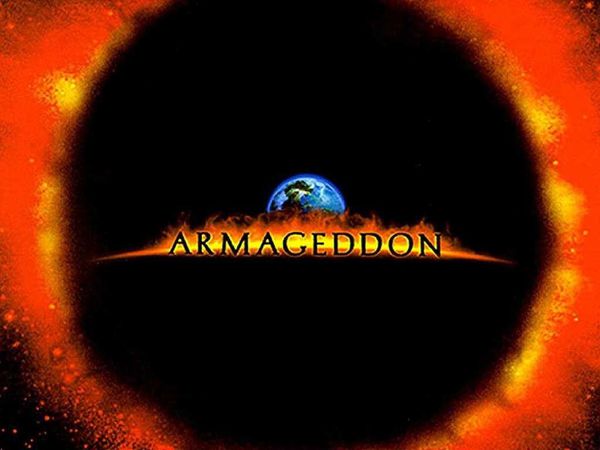








/image%2F1146095%2F20141207%2Fob_ff5f5b_oliver-wetter-port03.jpg)
/image%2F1146095%2F20150214%2Fob_c9c312_yelblu.jpg)