
Edmond est un peu la confirmation que Stuart Gordon se réoriante (son film charnière étant le monstreux King of the ants, une vraie bombe !), car un peu comme son collègue Cronenberg, il délaisse l’univers de la série B pour s’intéresser à des thèmes plus psychologiques. Ici, point de monstres, mais une psychologie de la frustration particulièrement bien étudiée, incarnée par son héros Edmond, un homme d’affaire banal qui décide une nuit de repartir à zéro, d’abandonner son ancienne vie et d’en commencer une autre. Par une série de simples rencontres et d’exemples choisis, Stuart parvient à faire un portrait de la rue prédatrice, qui te bouffe peu à peu tous tes biens si tu ne comprends pas ses règles, jusqu’à ce que tu finisses au fond du trou. Une descente aux enfers crédible, d’autant plus qu’elle s’adresse à des émotions qu’on a forcément déjà ressenti.
L’histoire : un soir de week end, Edmond, un cadre parmi tant d’autres, pénètre dans une boutique de voyance. La femme qui lui tire les cartes annonce alors qu’il n’est pas à sa place. L’annonce le remue, puis une fois rentré chez lui, il craque et décide de recommencer sa vie.
Un film assez subversif que cet Edmond (qui annonce déjà la couleur que prendra Stuck), puisqu’il s’engage dans une mécanique perverse, qui montre combien le monde posé du métro-boulot-dodo (forcément frustrant, chaque jour se ressemblant, à l’exception de petites frustrations quotidiennes comme le décalage d’un rendez-vous) contraste avec celui de la rue, composé de prédateurs plus ou moins organisés qui vivent sur le dos des uns et des autres, et où tout devient rapidement prétexte à tirer du fric à son prochain. Le film commence son entrée doucement par une conversation de comptoir entre un autre cadre inconnu et Edmond, chacun donnant sa vision de la vie, et ce qui est nécessaire pour être heureux. Rapidement, Edmond se focalise sur son besoin sexuel, frustré il y a longtemps par une épouse qui se contente de survivre avec lui (et qui l’engueulera avant de le foutre dehors à l’annonce de son projet, ne supportant pas l’idée de perdre le contrôle de son quotidien, et croyant le reprendre en jouant les vierges offusquées). Il se met donc en quête d’une prostituée dans divers clubs, mais à chaque fois il est rebuté par un protocole qu’il ne comprend pas, et qui n’existe que pour lui tirer un peu plus de fric. Il s’offusque à chaque fois contre ces procédés d’escrocs, mais il ne parvient qu’à s’attirer plus d’ennuis, finissant battu et dépouillé au fond d’une ruelle. C’est à partir de cet évènement qu’il va changer radicalement, obligé de se séparer de son alliance chez un prêteur sur gage, qu’il échangera contre un couteau de survie. Et là, dès qu’il se fait agresser, il réplique par une violence dévastatrice, qui lui apporte le soulagement de la vengeance des années d’humiliation et de frustration qu’il a accumulé. Il est d’ailleurs particulièrement subversif de voir Edmond tabasser un noir qui tentait de le rançonner, et de l’entendre dire « nègre » à toutes les phrases, le racisme apparaissant comme un caractère omniprésent qui ressort dès qu’il en a l’occasion. Et c’est à partir de cet évènement que le film change de ton, Edmond ayant constaté que la force lui permet de s’imposer (et paradoxalement d’exister) en face d’individus, mais que son comportement nuit gravement à la société. Il sort son poignard désormais à la moindre frustration, et se révèle bientôt incapable de canaliser ses sentiments quand il s’engage dans une conversation profonde, où il est persuadé que sa sincérité le place comme détenteur de la vérité. Le film dérape alors sur le pétage de câble de son personnage et le suit dans sa descente, jusqu’au plan final qui en laissera plus d’un abasourdi. Un peu comme Joel Shumacher et son Chute libre ou Gaspar Noé et son Seul contre tous, Stuart Gordon suit un parcours psychologique, d’un individu amoral qui tente de combattre les frustrations de son quotidien sans pouvoir y changer quoi que ce soit. La force du film repose beaucoup sur les épaules de l'acteur principal William H Macy, totalement dévoué au film, ainsi que sur ses seconds rôles jouant juste (on reconnaîtra quelques bouilles familières comme celle de Jeffrey Combs). Violent, subversif et sincère du début à la fin, Edmond est un petit thriller qui n’arrête pas d’évoluer, qui se met au niveau du spectateur pour développer ses arguments (tous ses personnages sont des gens de la rue, de la serveuse du bar au flic de quartier en passant par les voyageurs du métro), et donc les pistes de réflexion devraient enthousiasmer les amateurs de psychologie critique. Une vraie bonne surprise, et un nouveau départ pour Stuart !
5/6
2005
de Stuart Gordon
avec William H. Macy, Julia Stiles







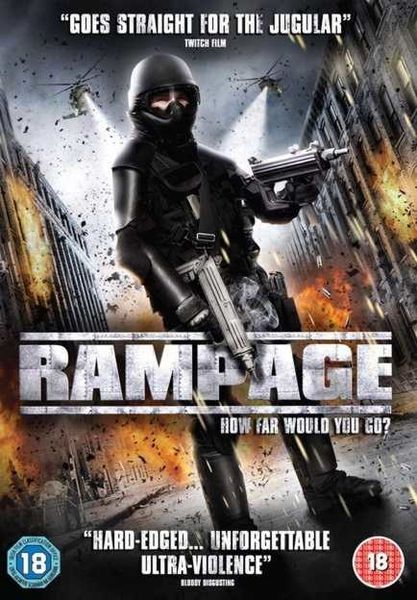

.jpg)
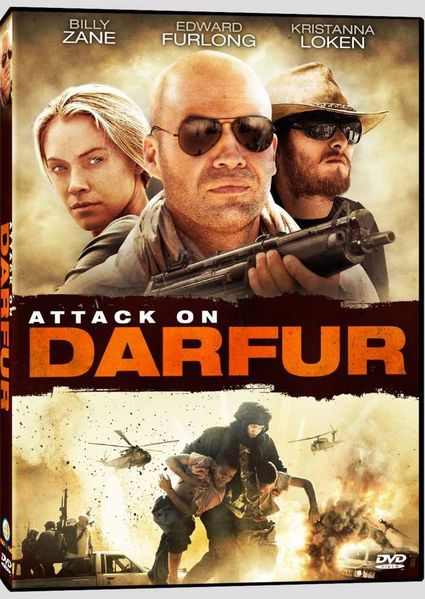





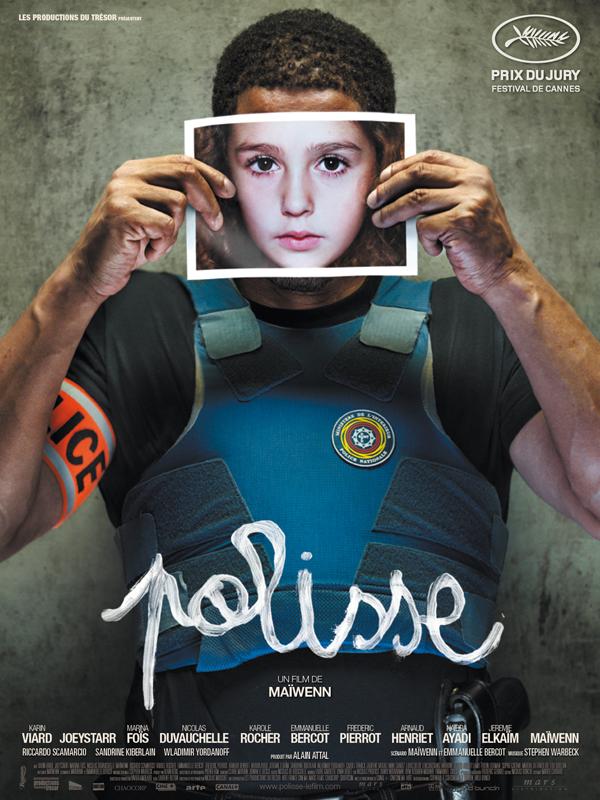













/image%2F1146095%2F20141207%2Fob_ff5f5b_oliver-wetter-port03.jpg)
/image%2F1146095%2F20150214%2Fob_c9c312_yelblu.jpg)