
Avec Caché, Michael Haneke s’attèle à une nouvelle étude du comportement humain : la famille se sentant harcelée qui retourne sa peur envers ceux qu’elle côtoie. Avec de nombreux détails, Haneke fait un portrait psychologique de chacun de ses protagonistes, et se livre à des conclusions plutôt intéressantes, dans un style toujours amoral, qui surprendra d’autant plus que le film contient quelques éléments de thriller plutôt convaincants. Retour sur un film qui avait fait du remous à Cannes lors de sa sortie.
L’histoire : depuis quelques temps, Anne et George Laurent reçoivent des cassettes les filmant lors de leurs sorties de domiciles, sans explications autres que des dessins représentant un garçon crachant du sang.

Un point de départ bien énigmatique que nous expose le film de Michael Haneke, qui s’aventure une fois de plus dans les méandres du comportement humain, en s’intéressant cette fois ci à la notion de culpabilité. Ou plutôt d’absence de culpabilité. Pour procéder dans la logique, partons de la situation qu’explore d’abord le film : la suspicion. On ignore tout de l’auteur des cassettes, et celles-ci ne contiennent rien de compromettant. Ce n’est donc pas une tentative de chantage. Mais les cassettes filmant leur demeure, et eux n’ayant aucun souvenir d’avoir vu une caméra quelque part, ils commencent à se faire une parano, et à devenir agressif avec leur entourage. Les époux commencent à se chercher noise, la femme insistant pour que son mari la mette au courant de ses doutes, et lui refusant sous prétexte de la ménager, alors qu’il essaye de dissimuler sa culpabilité. Car ce qui est caché dans ce film, ce n’est pas l’auteur des cassettes (on le retrouvera au milieu du film), mais bel et bien le passé, puis la culpabilité de George Laurent. On ne saisira l’incroyable complexité du personnage (ou plutôt sa simplicité, dépeinte par une multitude de détails) qu’après une première séance d’explication avec l’objet de ses doutes. Car le personnage de George Laurent, c’est la culpabilité qu’on cherche à cacher à tout prix. Pour un banal caprice d’enfant (aux conséquences certes graves, mais pas dramatiques) qui le hante depuis des années, George a toujours chercher à minimiser son erreur et à vouloir la cacher (les informations qu’il finira par donner à sa femme ne sortiront pas sans insistance de sa part, cette dernière finissant par remettre en cause leur vie de couple tant ses inhibitions concernant son passé sont grandes). Il faut voir ses expressions quand il raconte les faits, et comment il traite son ancien camarade une fois qu’il le retrouve. En face de la personne à qui il a nuit pendant son enfance, il se montre menaçant, agressif, et a l’attitude exactement opposée à celle qu’il conviendrait d’avoir (tous ceux qui visionneront la vidéo le lui souligneront). Pendant tout le film, il cherchera à étouffer la situation, et il parviendra finalement en méprisant davantage la personne blessée à se persuader de son innocence dans cette regrettable histoire. Et pour enfoncer le clou, Haneke lance l’épisode de l’enlèvement, où leur fils Pierrot disparaît et où George et Anne envoient les policiers dans le domicile de l’auteur présumé des cassettes, qui se fera embarquer avec son fils. Le lendemain, le fils Pierrot est retrouvé. Pas d’excuses, George se recentre sur sa vie et ne pense plus à l’auteur, qui le rappellera avant de commettre l’irréparable (La scène choc du film, qui fait bondir au plafond par son intensité). Et là encore, même en face du fils de ce dernier, George trouvera encore le moyen de dire qu’il n’a aucune responsabilité et de vomir sur tout ce qui le renvoie à ses craintes. Daniel Auteuil joue parfaitement son rôle, et finira par se cacher dans un chambre, restant dans les ténèbres pour tenter de soulager sa conscience. Cacher ses fautes, voilà ce qui est au centre du film. Quelques questions restent cependant en suspens. Qui est l’auteur véritable des cassettes ? Malgré ses démentis formels, je pense qu’il s’agit de l’ancien camarade de George. L’hypothèse d’avancer que c’est George lui-même qui en est à l’origine est tentante, mais ne tient pas la route pour la séquence dans l’appartement. Peu de chance que ça soit Anne ou Pierrot, les deux personnages ignorant tout du passé de George. Haneke ne donnera pas d’indices, il se contente de filmer les faits, et de montrer comment la famille part de tous les côtés dans un climat de peur et de méfiance mutuelle. Sans atteindre l’aboutissement d’un Le ruban blanc, ou même d’un Funny Game US, Caché est un film qui interpelle (pour peu d’y réfléchir quelques minutes pendant le générique de fin) et qui fait preuve d’une direction d’acteur assez fantastique, chacun jouant au ton parfaitement juste. Un joli travail que maître Haneke a encore accompli.
4.5/6
2003
de Michael Haneke
avec Daniel Auteuil, Juliette Binoche







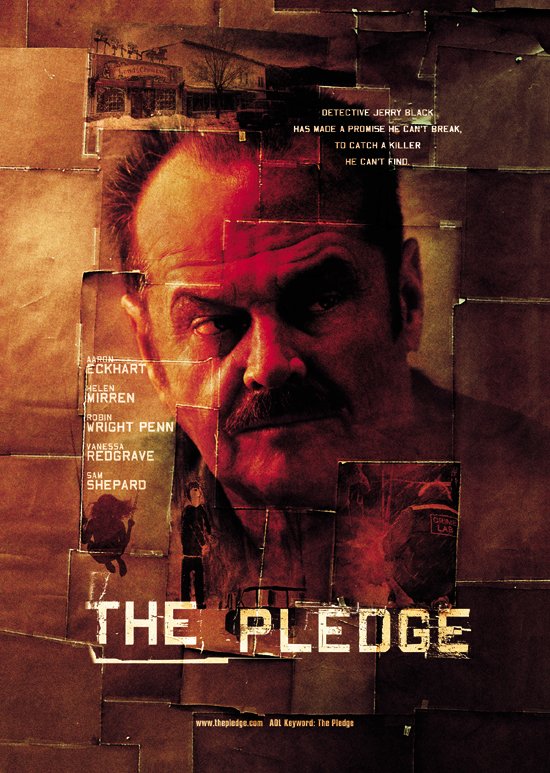






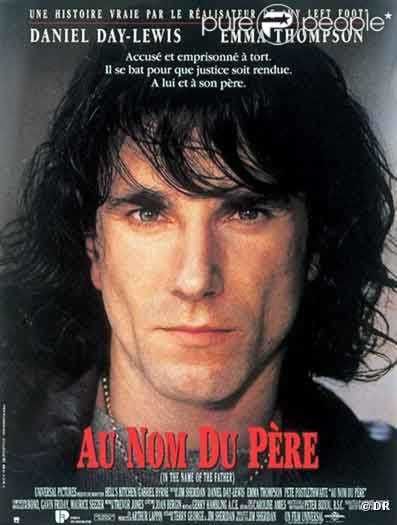




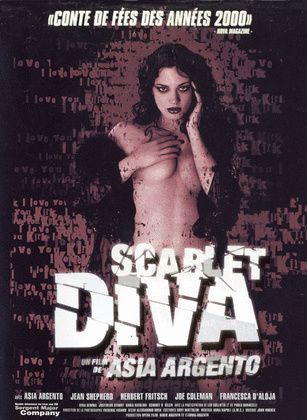






/image%2F1146095%2F20141207%2Fob_ff5f5b_oliver-wetter-port03.jpg)
/image%2F1146095%2F20150214%2Fob_c9c312_yelblu.jpg)