Avec la planète des singes, on avait découvert un blockbuster audacieux qui transcendait la commande du matériau original et nous propulsait au coeur d'une révolution simiesque aussi enragée que communicative. La suite, on l'attendait tous avec impatience. Et la voilà qui arrive, sous la houlette de Matt Reeves, plutôt bon dans l'art de remaker (Let me in). Verdict : on est sur la mauvaise pente, mais ce n'est pas honteux.
L'histoire : Alors que 10 ans se sont passés depuis la propagation du virus, les humains survivants tentent de remettre en état un barrage pour subvenir à leurs besoins en énergie. Toutefois, ce dernier est sur le territoire des singes savants, plus nombreux.
Ah, il y a un parfum de déjà-vu qui flotte sur cet affrontement. Pourtant, c'était pas faute d'essayer de détourner nos attentes au cours d'une première moitié qui se révèle être la meilleure du film, à savoir une tentative de cohabitation direct entachée par un cliché humain si con qu'on souhaite direct sa mort. Mais le titre étant ce qu'il est, on sait que la situation va dégénérer, mais hélas, pas pour les bonnes raisons. Le film se vautre en effet sur plusieurs points, à la fois dans son scénario et dans ses détails. Si le cliché du connard à la gâchette facile est le principal problème de la première moitié, celle ci est un bon exemple de continuité vis à vis de son prédécesseur. En effet, elle se révèle plutôt conforme aux méthodes de communications des singes (via le langage des signes), ces derniers ne pouvant prononcer que des mots à une syllabes ou aux sonorités rudimentaires (un excellent point qui impose de regarder le film en anglais, la VF détruisant intégralement ce fragile équilibre). Et sur l'évolution politique et sociale des singes, elle est plutôt bien construite (même si on se demande quel rôle social jouent les guenons portant des ornements sur leur visage, ils n'ont pas encore de culte ou de concubines, que je sache). Et ce fragile équilibre se brise en mille morceaux quand la piste principale du script est découverte.
SPOILER :
Koba, le singe balafré du premier film, tente le coup d'état en assassinant César avant de faire accuser les humains. Ce singe développe dès le début une haine des humains. Mais cette haine, franche et simple, est sans cesse remise sur le tapis, alors qu'on a déjà compris, et de voir alors ce personnage clairement secondaire squatter le devant de la scène, alors qu'il cumule toutes les tares en mode gros cliché, c'est frustrant comme pas permis. Un banal putch avec en prime César qui a l'indécence de survivre pour revenir lui péter la gueule). Raahhhhh ! Putain de scénaristes paresseux ! Le plus frustrant, c'est qu'ils avaient en plus les bases du futur conflit : les singes s'estimaient supérieurs aux humains. Fascisme, ingérence, régulation d'un peuple menaçant mais aujourd'hui faible, il y avait largement matière à faire de la SF politique infiniment plus recherchée que ce cliché de scénario pondu en 5 minutes. Mais bon, le public est venu se divertir, on ne va pas se baser sur son intelligence. Et voilà que Koba (je vais l'appeler kabo à partir de maintenant) se met à parler en sortant des phrases construites avec des notions sortant du cadre simiesque ("on va leur faire payer !" vraiment ?), ils traquent les humains mais ne les tuent pas (ou pas beaucoup), Kabo agresse tous les principes de base de la société des singes et personne ne le remet en question... Les tares s'ajoutent les unes avec les autres. La meilleure, Gary oldman (bon personnage, moins con que ce que la bande annonce laissait présager) se sacrifie pour faire s'effondrer un immeuble... qui s'ébranle à peine avant ce rester bien en place. Un épic fail digne d'un The dark knight rises.
FIN DES SPOILERS
On arrive à la fin du film en se disant : "tout ça pour ça", un blockbuster à la carrure de suite faible qui exploite sans vergogne les bases sans les développer davantage. Heureusement, la débâcle scénaristique fout les singes dans la panade, les voyant maintenant obligés de faire face à un conflit qu'ils ont déclenché, plantant des bases solides pour le 3ème épisode (hélas annoncé à nouveau sous la direction de Matt Reeves). On peut s'attarder sur la facture technique, je laisse les geeks admirer le réalisme des singes, naturellement plus poussé ici pour filmer les nombreuses scènes d'action du métrage. De même, les personnages humains sont plutôt réussis dans l'ensemble. Côté singe, tout le monde est au rendez-vous, on ne peut hélas que déplorer la présence du fils de César, qui affiche une gueule de benêt pendant l'ensemble du long métrage. En résulte un gros morceau décevant, qui se révèle être le gros pétard mouillé de l'été, gâchant le potentiel qu'on lui offrait sur un plateau.
2014
de Matt Reeves
avec Andy Serkis, Jason Clarke
3/6
commenter cet article …



























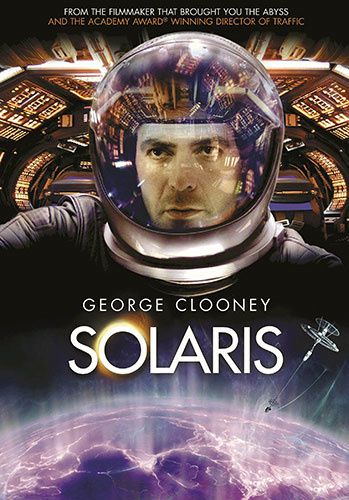




/image%2F1146095%2F20141207%2Fob_ff5f5b_oliver-wetter-port03.jpg)
/image%2F1146095%2F20150214%2Fob_c9c312_yelblu.jpg)