
American McGee Alice reste un très agréable souvenir pour les gamers amateurs de jeux en marge. Pour rappel, ce jeu de plate forme parvenait à tirer son épingle du jeu en offrant une relecture psychotique (et minimaliste) d’Alice au pays des merveilles, mais avec une Alice souffrant de troubles psychologiques. Les voyages oniriques peuplés de monstres trouvaient parfois un second niveau de lecture, et le postulat permettait tout simplement aux créateurs de se permettre absolument tout ce dont ils avaient envie (seuls les personnages ont été repris pour animer le voyage). Des années après ce premier essai fructueux, une suite voit le jour, bénéficiant de graphismes léchés. Le retour au pays de la folie tient-il ses promesses ?
L’histoire : Après l’incendie de la demeure familiale et sa sortie de l’asile psychiatrique, Alice Liddle est placée dans un orphelinat, sous la direction d’un psychiatre insistant pour qu’Alice oublie les souvenirs de l’accident. Alors qu’elle déambule en ville, elle est sujette à des évanouissements qui la ramènent au pays des merveilles.

Home Sweet Home, comme dirait Michael Meyers. On se sent immédiatement de retour chez soi dès le début du jeu, qui démarre très vite en mettant en scène des visions très torturées illustrant le traumatisme de notre héroïne. Il est intéressant de noter que si l’ambiance du premier jeu tirait parfois sur le glauque, il restait relativement innocent (gothique burtonnien surtout), alors qu’ici, le jeu utilise clairement des procédés horrifiques assez déstabilisants (l’apparition des hommes criquets terrifiante, la transformation de certains personnages en monstres) qui provoquent l’inquiétude. En fait, nous ne sommes pas à l’abri d’un sale truc pendant les cinématiques, surtout qu’à son intrigue, des allusions sexuelles se mêlent au récit, et que le portrait de la vie réelle dans laquelle évolue Alice (de très courts niveaux faisant transition entre les chapitres) est tout simplement étouffant. Avec un sommet de glauque pendant le séjour à l’asile, où les méthodes de cures se transforment en hallucinations gorrissimes très agressives. Une densité très sombre inattendue, mais qui contribue grandement à l’ambiance de l’ensemble. D’ailleurs, comme pour son prédécesseur, l’ambiance est véritablement le ciment du jeu. Si le premier conservait une certaine cohérence (limitée, certes), celui-ci régresse au stade de la schizophrénie scénaristique. L’histoire est en lambeaux, la cohérence n’est que ponctuelle, même les dialogues, incompréhensibles, dissuadent rapidement le joueur d’y trouver une quelconque signification. Si le contenu psychologique est bel et bien présent, il ne passe que par des symboles gros, évidents ou facilement notables. Mais heureusement, question cohérence, les ambiances de chaque chapitre (à l’exception des deux derniers) sont incroyables. La forêt enchantée, l’usine du chapelier, les fonds marins, les montagnes japonaises… Chaque nouveau chapitre est une féérie, qui laisse apparaître un nouveau bestiaire, de nouvelles ambiances et quelques surprises (les niveaux bonus, les énigmes…). L’incohérence de la narration est largement rattrapée par le foisonnement d’idées visuelles qui jalonnent le parcours de notre héroïne, aussi, il est conseillé de prendre son temps pour admirer tout simplement la beauté des décors. Il n’y a pas d’autres points positifs à chercher, c’est tout simplement une œuvre d’ambiance.

En guise de petits bonus, l’arsenal bénéficie de quelques innovations jubilatoires (le moulin à poivre est la meilleure), qui compense le nombre par la possibilité de faire évoluer les outils à disposition. Malheureusement, le dénouement d’Alice Madness returns déçoit, la faute aux deux derniers niveaux (la maison des poupées se révèle d’une pauvreté visuelle incompréhensible (malgré l’idée amusante d’un flipper en niveau bonus), et le train infernal, annoncé depuis le niveau 2 comme une conclusion badass, est bouclé en… 20 minutes. Dont 10 occupées par les cinématiques. L’ambiance n’est pas exploitée, le boss final rapidement expédié, c’est à croire que les développeurs ont manqué de temps pour rajouter des wagons et quelques défis. Une note finale amère, vraiment agaçante au vu des excellentes qualités affichées sur 75 % du jeu. Avec un gameplay agréable au cours des combats et de très belles idées pour les plates formes explorées (allant du gothique light au gore organique en passant par le steam punk) et pour le scénario (l’identité de la reine rouge, le visage du Mal…), Alice dépose le bilan en s’affirmant comme un bon jeu à prendre pour ce qu’il est, sans chercher la subtilité (malgré le raffinement), hélas gâté sur la fin.
4,5/6
2012
de American McGee & Spicy Horse





















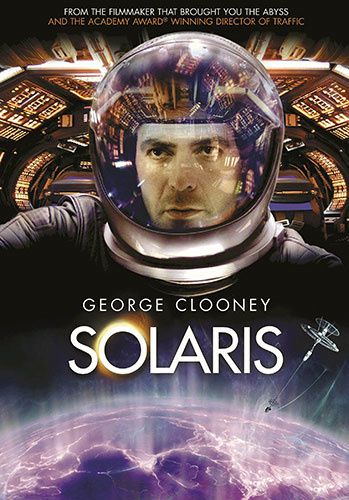

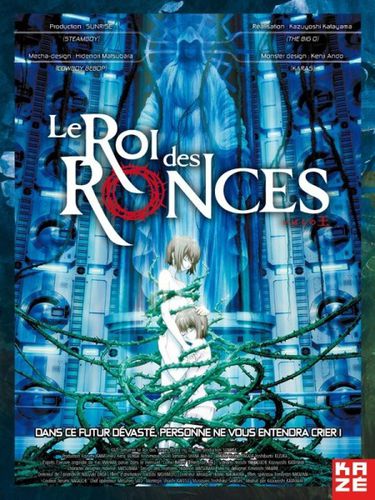

/image%2F1146095%2F20141207%2Fob_ff5f5b_oliver-wetter-port03.jpg)
/image%2F1146095%2F20150214%2Fob_c9c312_yelblu.jpg)