
Cloud Atlas marque le retour en grandes pompes des frères Wachowski au genre qui a fait leur gloire : la Science fiction. Glorifiés par la trilogie Matrix qui perd en qualité à chaque épisode (Quasi chef d’œuvre / actionner barré / navet à effets spéciaux), ils se sont égarés dans quelques projets annexes (le médiocre Speedracer et l’ultra surestimé V pour Vendetta) avant de s’atteler à Cloud Atlas, belle montagne d’ambition. Casting complexe réutilisant de grands acteurs pour au moins 4 rôles chacun, des périodes de temps allant du XVIème siècle au XXIIème, une narration éclatée et moins d’effets spéciaux tape à l’œil (aucun bullet time), les qualificatifs ne manquent pas pour nous promettre le paradis… Hélas, comme V pour Vendetta le laissait apercevoir, les Watchowski ont une vision du monde peu satisfaisante sur bien des points, et cela se remarque à nouveau ici.
L’histoire : La réincarnation existe, l’histoire n’est qu’un perpétuel recommencement, qu’elle se déroule du temps des esclaves ou dans le futur proche. Sans le savoir, nous suivons des personnes qui, sans se connaître, se sont déjà connus ou rencontrés…

Pour aborder la montagne Cloud Atlas (près de 3 heures, au moins 5 récits qui s’entrecoupent continuellement, des acteurs qu’il faut reconnaître ou retrouver (Tom Hank est le plus facile à repérer avec Hugo Weaving)…), il faut s’organiser un minimum, voire revoir le film plusieurs fois pour le maîtriser intégralement. Pour ce qui est de la fameuse transe métaphysico-théologique chère aux Wachowski, elle revient ici dans l’évocation de la réincarnation, directe vers la fin, sinon visible pendant tous le film (quand on finit par reconnaître les acteurs dans différents rôles, on commence à se douter de quelque chose, et quand ils commencent à insister pour dire qu’ils sont déjà venus dans certains lieux ou ont déjà entendu certaines musiques, le doute n’est plus permis). Une intention intéressante quand on commence à se pencher sur le cas de chaque acteur, qui interprète son personnage dans des bases comparables, mais dans des contextes et des époques différentes. Tom Hank est celui qui saute aux yeux, incarnant au moins deux méchants dans le passé et un méchant « dompté » par sa vie de famille, qui suit son instinct pour mieux le contrarier in fine. Une composition intéressante, mais qui s’arrête là, hélas. D’ailleurs, c’est bien en cela que Cloud Atlas déçoit. Au-delà de l’illustration de la réincarnation, que reste-t-il ? Des destins individuels, lourdement sacralisés selon les circonstances (petit esclavagiste devenant étendard de la liberté, petit vieux prenant sa revanche sur un monde effrayant, petite clone qui devient représentative de l’humanité artificielle, petit chasseur qui devient sauveur d’une humanité en voie d’extinction), qui revendiquent d’être des pionniers parce qu’il en faut pour faire bouger le monde, bousculer l’ordre établi, avancer en somme. La leçon de vie est polie, convenue, d’un démagogisme tout à fait impersonnel, et faite pour qu’on apprécie. Quel dommage que plusieurs personnages se sentent obligé de revendiquer quelque chose, histoire de se rassurer de n’avoir pas rien fait dans sa vie.
Cloud Atlas, c’est en quelque sorte Magnolia, sans les performances d’acteurs ni les personnalités attachantes. Les personnages sont ici lisses, sans particularités, facilement transposables, et surtout, chacun couvre avec son histoire quelque chose de cher aux scénaristes. Les deux meilleures histoires sont probablement celles avec Tom Hanks et Halle Berry dans le futur, et celle avec le petit esclavagiste qui s’attache au sort d’un esclave pendant une traversée en bateau (mis à part la fin, d’une prétention libertaire aussi anachronique qu’irritante).
Celle de l’éditeur tentant de s’échapper de la maison de retraite est d’un ennui poli, avec son humour pompeux mais de bon aloi (nos retraités se la jouent grande évasion) et sa conclusion mielleuse, faisant patienter plus qu’elle n’apporte à l’édifice.
Vient ensuite la journaliste (Halle Berry) qui s’attache à révéler un complot d’industriel pétrolier visant à faire exploser une centrale nucléaire. On voit très bien où veulent en venir les Wachowski, la téméraire journaliste qui, de par sa ténacité et sa soif de vérité, fait éclater le scandale en sauvant sa vie et en gravant son nom dans l’histoire du journalisme. C’est tout, il n’y a rien à ajouter, et ici, ce n’est même pas drôle en comparaison de l’évasion de notre vieil éditeur. Toutefois, pas de revendications. Même si c’est bassement de l’exploitation de la théorie de complot, ça garde une certaine sobriété.
Sobriété qui est complètement éclatée avec la partie dans le futur, probablement la plus mauvaise. En effet, les Wachowski ont vu Soleil vert, et ils décident de nous le ressortir pour l’occasion, mais à moindre échelle. Si cette partie s’ouvrait d’une façon intéressante en traitant du statut de clone capable de penser et subissant des humiliations de clients peu respectueux, la quête libertaire ne cesse de gagner en lourdeur avec les minutes qui passent. Ainsi, le segment commence exactement comme un The island (dont il repompe pratiquement toutes les idées mythologiques (la loterie, l’isolement du monde extérieur…) avant de partir vers le combat contre la société à la V pour Vendetta. Parce que l’objetisation des clones n’est pas tolérable, m’voyez ? Enfonçant les portes ouvertes (« Ils nous traitent comme des choses, ce n’est pas bien. » dit la clone en pleurant, aussi devons nous pleurer nous aussi et adhérer à sa lutte pour la liberté), le film nous implique dans un combat déjà connu, dont l’issue est idéologiquement tracée (il faut considérer les clones comme des humains). Seulement, le film combat une société qu’il a lui-même créé, et qu’il se complaît à déshumaniser. C’est bien beau de combattre, mais si on combat une société aussi peu réaliste, où est l’intérêt ? J’ai peine à croire que fabriquer un clone coûte peu cher au point de le transformer en bidoche à peine quelques temps après sa fabrication. Ce recyclage humain est une farce, pour donner une lutte à nos personnage, quelque chose à faire pour s’occuper. Le héros masculin de cette partie est l’archétype du héros tel qu’il doit être pour être idôlatré, à savoir qu’il lutte, mais qu’il ne veut pas donner le coup de grâce. Il faut que ce soit « l’innocence » qui le fasse, l’être pur (donc notre clone ingénue). Et depuis, il attend. Ah, il est au courant que ses semblables se font décarcasser tous les jours, mais il attend d’avoir l’innocent pour faire les choses bien. Ah un moment, il meurt, mais non en fait, il revient sans la moindre explication. Quant à l’innocente en question… Elle est bien gentille, mignonne, et sexy quand elle s’envoie en l’air, mais il y a des moments où se taire est la meilleure option. Pendant la lutte finale, il faut qu’elle déblatère une philosophie de comptoir sur une musique new age (du genre « Les actes, qu’ils soient bons ou mauvais, influencent l’histoire. » Oui, en effet.) pour montrer qu’elle est devenue porte étendard de la cause, et qu’elle ira jusqu’au sacrifice car quand on défend un truc, faut pas être timide (n’est-ce pas, Matrix Revolution). Le sacrifice est ce qui permet au message de subsister (point commun de l’œuvre Wachowski, dans matrix revolution et V pour vendetta). C’est en effet le cas, mais quand ce sacrifice est spectaculaire, tourné vers le monde, mis en scène en quelque sorte. Au cinéma, ça marche, mais les victimes d’une dictature sont rarement dans la lumière des projecteurs (tout au plus laisseront ils des regrets aux gardiens, trop tard de toute façon...).
Je termine enfin par l’histoire de Frobisher, qui m’a le plus laissé indécis. Voyez-vous, depuis V pour Vendetta et sa consécration outrancière des homosexuels (sérieusement, le film les consacre en en faisant des martyrs modernes alors que la dictature qui les extermine n’a aucun intérêt à le faire, si ce n’est de devenir des néo nazis sans optique raciale), on sait que les Wachowski veulent faire des invertis des martyrs modernes. La peinture ici est subtile, mais ce qu'il en reste est pour le moins confus. Déjà, le principal personnage homo du film (Robert Frobisher) n’est pas vraiment homo, il est bi, et ses dissertations complètes sur ses sentiments se superposent à son appétit sexuel. Il s’envoit donc en l’air avec une juive de passage, et c’est beau, parce que c’est une rencontre (il écrit ça à son amant, qui doit lire ça chez lui et qui doit surement prendre la nouvelle avec jubilation). Et puis, en pleine soirée, voilà que notre homo se met à caresser son compositeur fétiche, un vieux de 80 balais… Mais c’est beau on vous dit, c’est ses sentiments homosexuels qui s’expriment… Quand on est incapable de dominer son désir sexuel, on a au moins la décence de ne pas faire passer ça pour du sentiment. Mais le personnage superpose les deux, provoquant le malaise pendant une courte scène, heureusement désamorcée par le vieux qui se met à rire, et qui du coup devient un gros méchant (parce qu’il a rit des avances que l’homo lui faisait, il devient un salopard d’enfoiré). Et histoire d’enfoncer le clou, le personnage se suicide, parce qu’il faut donner des airs de tragédie à cette histoire et consacrer le gay (ici, c'est plutôt justifié par le fait que pour que le morceau vive, il doit abandonner sa réputation éclaboussée par son homosexualité, et ainsi avoir accompli l'oeuvre de sa vie). Ce qui en fait le personnage le plus détestable de tout le film (qui porte d’ailleurs le nom du morceau de musique qu’il a écrit). Non content de faire souffrir son amant de la pire des façons (il lui écrit sans arrêt en repoussant toujours les retrouvailles), il se flingue en lui donnant une petite leçon sur le suicide, comme quoi ça demande du courage, que ce n’est pas un acte de lâcheté. Si, c’est un acte de faiblesse, mais ça réclame une petite dose de volonté (que certains humains n’ont pas). Et se suicider ainsi, en laissant son amant plein d’espoir complètement désemparé, c’est… comment dire… en dessous de tout. Espérons qu’il ne se réincarnera plus, celui là…
Cloud Atlas, malgré le dézinguage que je viens de lui faire subir, reste un blockbuster intriguant à découvrir, et intéressant dans son foisonnement d’idées. Toutefois, il se révèle être une déception, ne parvenant jamais à susciter plus qu’un modeste intérêt, et au pire un agacement redondant.
2/6
2012
de Lana Wachowski, Tom Tykwer, Andy Wachowski
avec Tom Hanks, Halle Berry












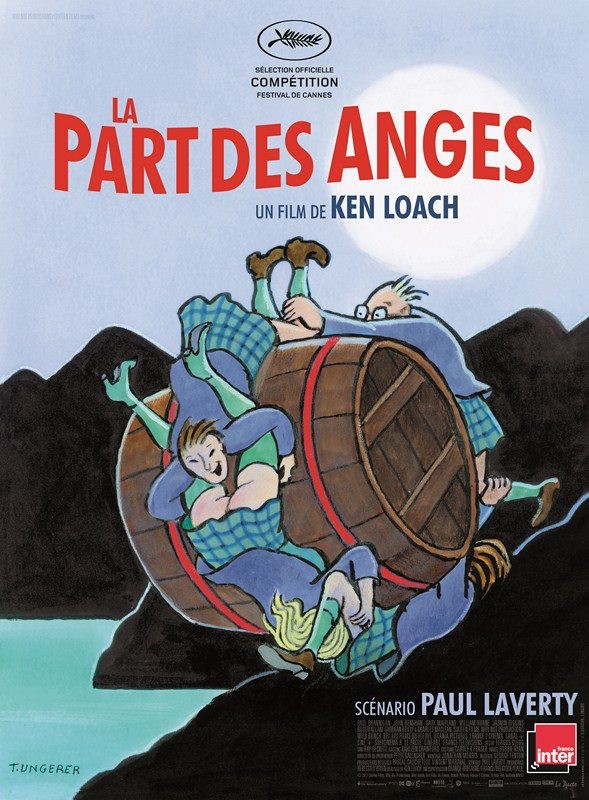










54822_16_11.jpg?partner=allmovie_soap)









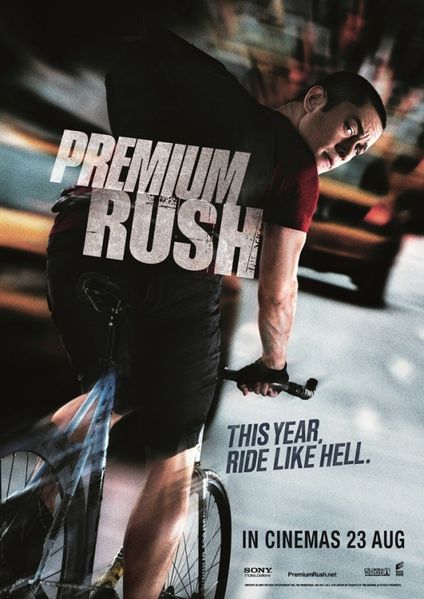


/image%2F1146095%2F20141207%2Fob_ff5f5b_oliver-wetter-port03.jpg)
/image%2F1146095%2F20150214%2Fob_c9c312_yelblu.jpg)